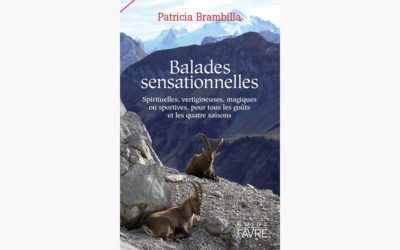hors champ
Suis-je vaurien ou vaurienne?
Ça s’annonçait comme du «classique»: inauguration d’un restaurant, discours des patrons et des édiles, buffet à foison en guise d’échantillon, commérages mondains jusqu’à l’extinction des feux. Pourtant, dans l’ambiance, il y avait quelque chose de plus… dont le pique-assiette n’a pris conscience qu’une fois bien repu.
«Spark» – sis à Plan-les-Ouates dans la zone de bureaux – veut dire «skills park», qu’on peut traduire par «campus des compétences»: c’est le nom de tout le bâtiment, et pas juste du restaurant au rez (campus-spark.ch). Mais ledit restaurant s’inscrit bien dans la logique de l’ensemble: il s’agit de recycler des chômeurs de la branche. Ce qui explique ce «je ne sais quoi» de plus: le personnel qui nous hélait de derrière les tables ou qui nous courait après avec un plateau avait une attitude, oh! certes pas «enfantine», mais tout de même un peu timide, sinon empruntée.
En tout cas, ce n’était ni la routine d’une cantine scolaire qui sert à la chaîne, ni l’amabilité de commande des échansons aguerris (tenus de dire «avec plaisir» cent fois l’heure). C’est que ces gens de profils variés et de tous âges «passaient leur examen», en somme: après des semaines de retour au front, c’était le moment où ils/elles montraient au monde extérieur de quoi ils/elles étaient capables. Dans un métier peu considéré, malgré les efforts rhétoriques des autorités: ainsi, dans la nomenclature de l’Office d’orientation, on ne trouve pas «serveur» et «serveuse» ni «sommelier » et «sommelière», mais «spécialiste en restauration».
L’adrénaline nourrit-elle son homme?
Le restaurant Spark à Plan-les-Ouates n’est pas le seul du genre: dans un numéro récent, on a évoqué «Birdhouse» à Blandonnet, œuvre de l’association française «Les apprentis d’Auteuil». Mais outre Spark – qui dépend de la Fédération des entreprises et du Département de l’instruction publique -, un établissement similaire se trouve aux Acacias, «Le Trinquet» (supervisé par l’Ecole hôtelière de Vieux-Bois), et un pour les «personnes en situation de handicap» à la route de Chêne, géré par les Etablissement publics pour l’intégration (epi.ge.ch, d’où son nom: «L’Episode»). A Spark, en tout cas, on a affaire à des chômeurs ou des «réorientés» placés pour quatre mois, histoire de les remettre dans le bain, de leur rendre confiance en eux, de rassurer les employeurs et d’ajouter une preuve dans un curriculum vitae: «Nous avons même une septuagénaire», put-on entendre. Mais pourquoi donc y a-t-il du chômage dans une branche qui se plaint d’un manque chronique d’effectifs au point de chercher chez les étudiants une force d’appoint?
A la cafétéria d’un congrès, une personne ayant quinze ans de métiers l’explique ainsi: «J’adore mon métier, surtout les jours où il y a grand afflux… et que le soir, je peux me dire «Ouf! j’ai tenu le coup!»; mais pendant la pandémie, pas mal de collègues chevronnés ont redécouvert les joies de la vie de famille et ont décroché… or les nouveaux venus savent à peine distinguer une fourchette d’une cuiller!». En bavardant le soir de l’inauguration, on remarquait qu’un senior craignait malgré tout de retourner au chômage dès le fin de son stage: «C’est un homme qu’un parent a fait venir de son village d’Italie lors d’une haute saison, mais qui s’est retrouvé le bec dans l’eau en basse saison».
Démagogie populaire?
Dans ces petits métiers, à chaque échange verbal, on découvre la richesse d’une vie de gens qui méritent bien leur titre – hélas! péjoratif – de «bon à tout faire». Jadis, dans les familles bourgeoises, on disait juste «une bonne»; et le gosse, pour qui c’était une seconde mère à l’heure du lever, du coucher, du manger, du laver… ne se posait pas de question sur un terme aussi incongru (de nos jours, on dit plutôt une «nounou»). Quand il sera plus grand, l’enfant saisira que «bonne» veut dire «bonne à tout faire». Et plus tard encore, il y repensera en lisant Tolstoï: dans un de ses contes, un homme meurt jeune d’une chute du toit, car c’était l’homme à tout faire, qu’on appelait dès que ses maîtres étaient dépassés par une situation: à l’étable, au jardin, à la cuisine ou sur le toit… alors «tôt ou tard, ça devait arriver».
Que de savoir-faire recèlent ces gens dont le titre ne vaut rien, mais sans qui rien ne va. Comme cette dame rencontrée au hasard d’un bus, qui commença sa vie adulte dans l’artisanat d’un pays chaud, puis travailla dans l’horlogerie genevoise, mais qui, entre deux âges, sent que «les portes se referment peu à peu… on se sent inutile» et on survit comme «femme de ménage».
On pense aussi à ces soubrettes de «Cosi fan tutte», là pour réparer les faux-pas de leurs maîtresses. Assez pour le pathos, qui n’est pas le fort de cette rubrique. Mais avant de conclure, le soussigné aimerait partager avec les lecteurs et surtout les lectrices une question qu’il se pose depuis longtemps mais qu’on aborde rarement: si la législation contre le harcèlement sexuel s’est beaucoup développée en une génération et fait trembler les machistes des grandes organisations, combien de pince-fesse ont lieu dans les petits bistrots sans que la serveuse sans papier ose en parler? Mais peut-on vraiment conclure de manière aussi frivole? Ces stages courts de deux à quatre mois, est-ce une formule qu’on pourrait appliquer à d’autres métiers? Les formations longues, où on a oublié à la fin ce qu’on a appris au début… le tout étant démodé avant qu’on ait commencé (mais déjà épuisé)… sont-elles condamnées?