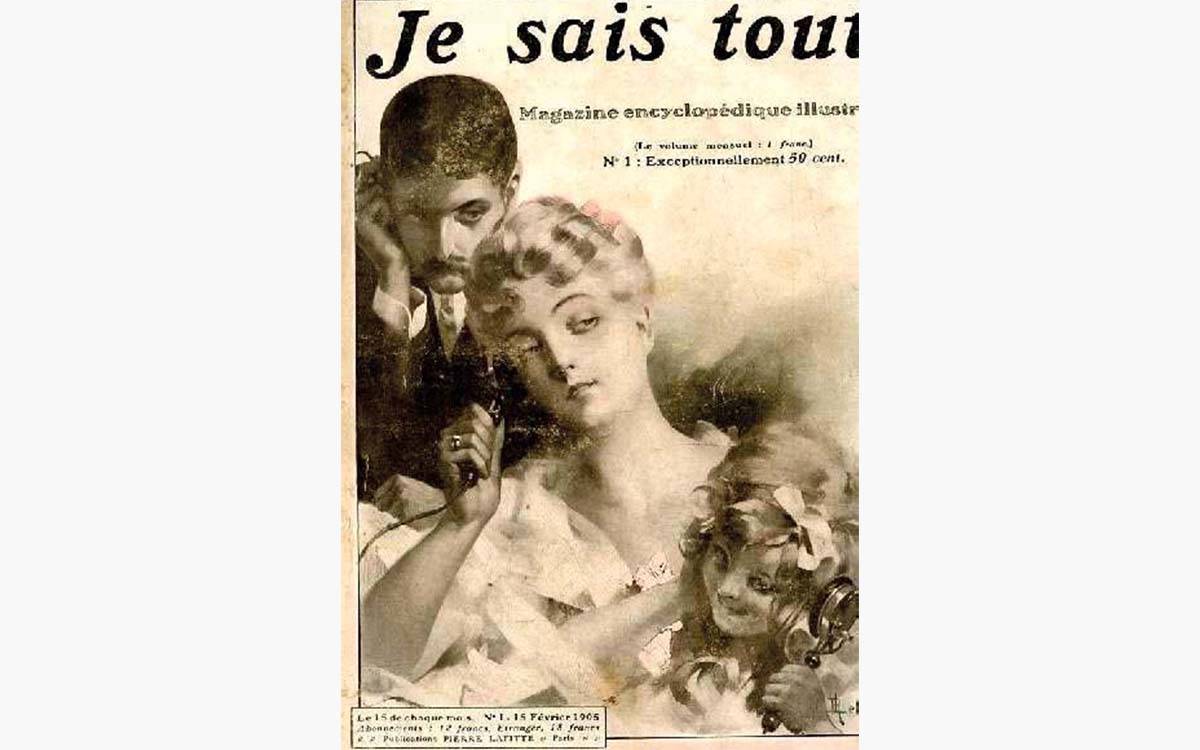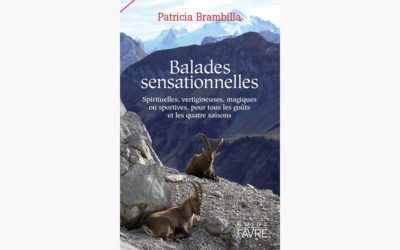hors champ
Mettre le savoir hors de lui
A quoi bon – quand on œuvre dans les médias – acheter puis entasser de vieux livres, sachant que le journaliste est «l’historien de l’instant» présent? Réponse simple: pour résister à la censure de l’histoire, qui commence dès… l’instant présent: on va le voir dans un de ces livres qui ne trouvent plus grâce aux yeux du monde savant, mais qui donnent leurs seules armes aux ignorants.
«Non! ce n’est pas juste une seringue de nostalgie, le vieux livre; c’est le meilleur vaccin contre les idées toutes faites!»: cet avis d’une libraire dans une ville de France ouverte sur l’Océan était certes intéressé; mais à la longue, le regard décalé est bel et bien ce qu’on peut tirer de mieux de ces pages jaunies face aux intox du jour, grandes comme des tours d’ivoire. A chacun son cri contre l’oubli (voir aussi archivescontestataires.ch).
Vérité ce jour, intox au-delà
«Le silence est d’or»: c’est encore plus vrai que le pensait l’auteur de l’adage; on fait passer le toc pour de l’or quand – pour boire – on a vendu les joyaux de famille et bâillonné les témoins. Traduit en langage d’un bibliothécaire imaginaire d’une discipline universitaire: bien des auteurs ou chercheurs de notre siècle auraient l’air de faussaires ou de plagiaires si on pouvait trouver d’un clic tous les échos du passé plutôt que les notes en bas de page où le savant cite son propre clan (ce qui est pour lui la marque de la «science»).
Par contre, l’or pur a souvent un air passé sous une terne patine: à première vue sur les rayons d’une brocante, le livre dont on va parler ici ne semblait guère plus inspirant qu’un vieil horaire de train. Et son auteur est tombé dans l’oubli autant que son sujet: le sujet, c’est Numa Droz, et l’auteur, un certain Alfred Georg, qui fut son émule. On trouve encore dans le catalogue de nos bibliothèques universitaires une demi-douzaine de pages avec Numa Droz et une poignée de références à Alfred Georg… mais sous des titres secs que nul n’osera tirer de leur sommeil. On n’y voit pas en gras le lexique qui de nos jours fait pétiller l’œil de l’historien: rien dans l’intitulé qui évoque la «justice» ou la «femme», par exemple; mais le pavé dont on parle ici avait tout de même un mot accrocheur dans le sous-titre.
L’avion à réaction va de l’avant
Sur la reliure, le titre sonnait réac: «Contre l’étatisme et la bureaucratie»; mais le sous-titre venait en contrepoint: «Souvenirs de luttes»; assez pour imaginer un cri libertaire d’avant le «socialisme scientifique»… quand une partie de la classe laborieuse voyait une issue à ses peines dans la libre coopération plus que dans une solide administration. Mais une fois feuilleté, l’ouvrage raconte une autre histoire: celle du plus jeune Conseiller fédéral de tous les temps, dont le bras droit Georg raconte les «combats» en citant des archives dont une ou deux vont laisser le lecteur coi. Pour l’instant, cadrons les héros de l’affaire: de droite ou de gauche, Numa Droz et Albert Georg? La question est anachronique: Droz fut un élu du Parti radical, ce qui ne fait que déplacer la question: par exemple à Genève, selon les moments et selon les auteurs, un James Fazy fut un révolutionnaire ou un affairiste. Et l’historien genevois de gauche Arnaud Boesch – il anime des Cafés d’histoire où on pourfend les «partis bourgeois» – a admis que le Parti radical, au tournant des XIXe et XXe siècles, n’était pas pour autant «réac»: «Je vous conterai un jour comment les Radicaux et les Socialistes ont rompu» a-t-il promis; on ne peut que pousser le lecteur à aller écouter un des rares érudits pas trop dans la ligne (aperosdelhistoire.ch). Retour à Numa Droz: d’origine modeste, apprenti graveur puis instituteur, il rêva un temps de partir au loin avec les Missions. Mais tout ça n’explique pas pourquoi on en vient à parler de Numa Droz dans Hors Champ.
Larmes de crocodiles?
L’auteur du livre, Albert Georg, rappelle une demi-douzaine de «causes» de son patron Droz au cours de sa carrière politique: en particulier, son opposition à la création d’une Banque nationale, au rachat public des chemins de fer, à une assurance étatique et au monopole syndical. Vus de 2025, de tels combats sonnent curieux, et bel et bien «réacs»… même si désormais Attac d’avant-garde en veut tout autant aux Banques nationales coupables d’inventer de l’argent au profit des banquiers.
Mais à force de feuilleter le livre, on tombe sur ce qui laisse le plus bouche bée un lecteur du siècle présent: le travail des femmes (surprise pour un lecteur du siècle présent… car du temps de Lucy dans le Grand Rift, le travail des femmes allait de soi)! On y découvre que les syndicats d’alors étaient outrés qu’on permette aux femmes de trouver des emplois (dans l’horlogerie ou l’imprimerie, par exemple). Ils clamaient haut et fort que la place des femmes était au foyer, et non en ouvrières qui faisaient aux hommes une concurrence indue. Alors que les radicaux comme Georg et Droz s’inquiétaient de ce qu’allaient devenir les femmes sans mari car «il naît bien plus de femmes que d’hommes, en tout pays». Sans recourir au vocable, le texte fait comprendre que le salariat féminin était le meilleur antidote à la prostitution. Ces thèses – telles qu’elles sont énoncées dans ledit livre à propos des dizaines de milliers de femmes sans famille – n’émanent pas de négriers; elle semblent donc sincères… au point que Georg et Droz ironisent à l’inverse sur l’hypocrisie des arguments «philanthropiques» invoqués par les syndicalistes.
A l’époque, d’ailleurs, le réflexe syndical était au monopole: à gauche, on exigeait que les patrons n’emploient que des travailleurs syndiqués; l’autre camp voyait là de l’«égoïsme»; mais de nos jours, on n’ose plus user de tels gros mots pour parler des partenaires sociaux. Tout au plus trouve-t-on – sous Google sinon dans ChatGPT – des textes comme «De l’égoïsme de caste à la conscience de classe», «Le difficile altruisme des groupes d’intérêt», «Are unions greedy?»… Le premier de ces trois titres ne dit pas si la conscience de classe est plus élevée que la conscience de clan, mais Margaret Thatcher avait sur cette question un avis tranché. A noter que «Toujours plus», le fameux livre de François de Closets, n’est pas assez «scientifique» aux yeux des catalogues savants pour crever l’écran.
Le gène de l’académisme
Autre trouvaille providentielle à Gaillard dans une boîte d’échange de livres: La «Revue syndicale suisse 1980»; qu’est-ce qui a pu pousser un Gaillardin à garder près d’un demi-siècle le tome 1980 de l’Union syndicale et à s’en défaire soudain? A noter que cette «Revue» – une fois reliée de toile – est plutôt un bilan annuel avec des articles de fond. Les années septante étaient celles où la social-démocratie essayait encore de structurer sa pensée entre le capitalisme et le stalinisme, si bien que ladite Revue publiait des textes pas tous convenus. Ainsi, dans le tome de 1980 – où on ne met plus du tout les femmes au foyer – on pouvait trouver un discours de Willy Brandt à l’Organisation internationale du travail contre le protectionnisme qui acculait le Sud à la misère ainsi que – surprise au carré – un texte oublié d’Albert Camus.
En quoi ce propos de Camus – «Le pain et la liberté»: un discours prononcé à la Bourse du Travail de Saint-Etienne en 1953 – est-il intéressant? C’est une ode à la liberté, moins courte mais plus claire que le poème de Paul Eluard, et sans doute ladite Bourse n’était pas celle de la Confédération générale du travail, qui alors portait le deuil de Staline. Mais là aussi, lu en 2024, le texte de Camus réserve encore des surprises… marginales: dans une phrase peu claire, l’écrivain s’en prend à l’Unesco et au général Franco «au palais de la culture»: surtout, il déplore qu’on puisse répondre «Mais la Pologne est bien membre de l’Unesco», ainsi que d’autres «démocraties populaires» où on pend des historiens. De fil en aiguille, le soussigné va voir quand Franco est allé à l’étranger (il n’est jamais allé aussi loin que Paris), et surtout s’il a bel et bien payé les fresques prométhéennes de José Maria Serts à la Salle du Conseil au Palais des Nations (Serts les avait commencées sous la République, mais était devenu entretemps «nationaliste»… tout en luttant pour une convention sur le patrimoine artistique en temps de guerre: un héros des voyages en zigzag).
Penser pour ou contre… soi-même
Quelle «moralité» tirer de cette fable décousue le long des chemins de traverse et parfois dans les sens interdits que parcourent des livres tombés des rayons par hasard? Et encore, ces deux-là ne sont rien à côté d’une collection dépareillée de «La Revue des Deux Mondes», de «Lectures pour Tous» ou de «Je Sais Tout» ou encore de la genevoise «Bibliothèque Britannique» (pour s’en tenir à la presse en notre langue). Revues où se côtoient les plus visionnaires – sur le colonialisme, le pacifisme, le progressisme, le féminisme – et le plus cocasse, sur la parenté des Japonais et des… Juifs (ce qui explique pourquoi dans les années quarante les Japonais ont refusé de tuer les Juifs de Shanghaï comme le demandait Berlin?). Sur la Chine, on y trouve pêle-mêle des pages sur le «péril jaune», contre les clichés sur les «supplices chinois» et une interview de l’impératrice, excellente calligraphe mais embarrassée quand la journaliste lui demande d’écrire le titre de son magazine en chinois: «Je sais tout».
De toute façon, le sujet de cet article n’est par l’égoïsme syndical, qui n’est pas pire que l’égoïsme patronal, même s’il saute moins aux yeux. C’est plutôt la censure du temps sous la barre des grands timoniers de la science avec conscience: à une récente soirée au CERN, ce fut un artiste (assez savant, il est vrai) qui a plaidé le «droit de parler quand on ne sait rien». Non, la science est chose trop vitale pour être laissée aux rats de laboratoire: ce que l’érudit devrait dire au journaliste, c’est – à chacun son rôle – «va voir au marché aux puces si j’y suis!». Car la pensée est en général bien loin du savoir: elle doit même le fuir pour ne pas étouffer… comme dirait Roland Junod – prof à l’Ecole «sociale», mais ne voulant pas s’y tenir – quand il citait «Penser contre soi-même» à un café philo sur le bateau Genève.