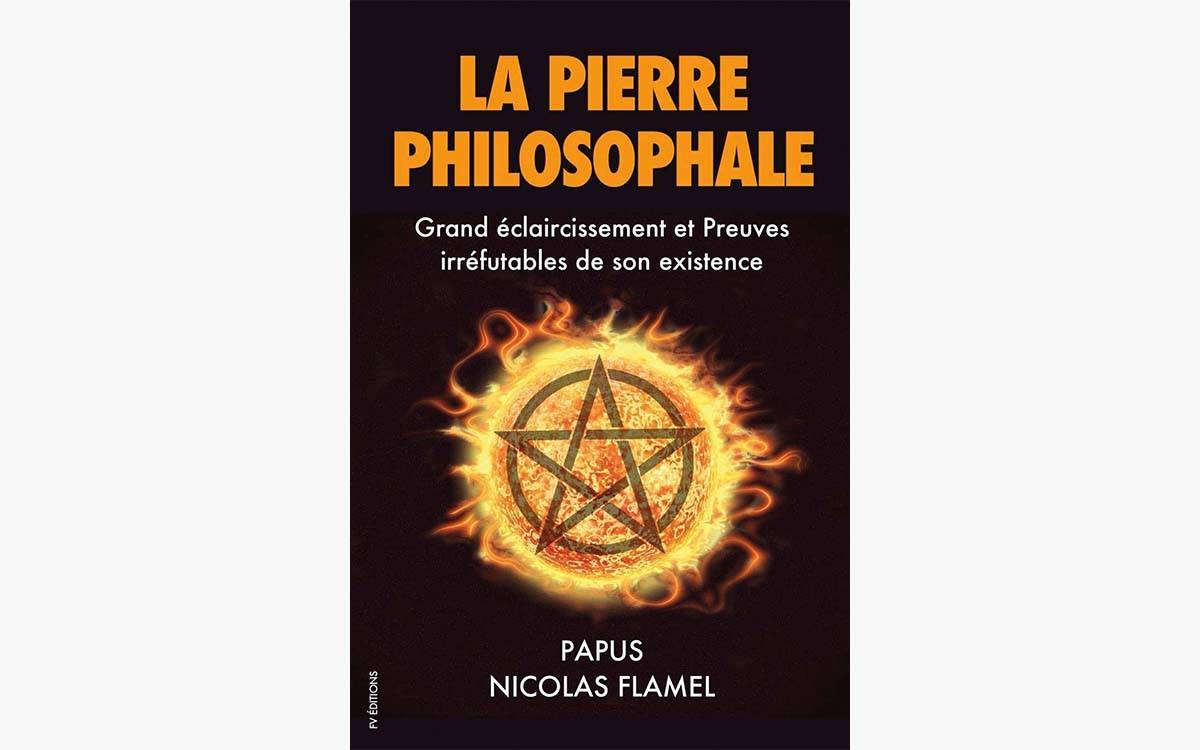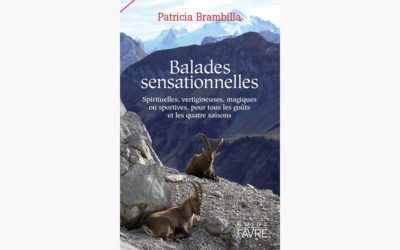hors champ
Le profit a-t-il de l’esprit?
Deux «études» sont sorties ces temps sur les milliards générés par les millions dépensés pour l’éducation ou la diplomatie: en gros – que les égoïstes se rassurent – chaque franc investi dans l’esprit en rend cinq en profit. Mais l’inverse est-il vrai: ces cinq francs de profit sont-ils bel et bien fruit de l’esprit, et chaque franc mis dans la diplomatie crée-t-il de la concorde?
Quelle mouche a piqué les milieux les plus glorieux de la modernité, qui les pousse à prouver leur utilité à coups de chiffres? Le vrai, le bien, la paix… leur valeur allait de soi aux temps modernes. Eh! bien non, ça n’a plus l’air d’aller de soi, et depuis le début de ce siècle dans notre pays, on a vu sortir des rapports chiffrés «prouvant» qu’une aide publique était d’intérêt public non juste pour l’école ou la santé, mais aussi pour la culture et les médias. Que même les Universités de pointe et les Droits de l’Homme doivent se livrer désormais à de tels calculs d’épicier est un signe des temps post-modernes.
Les esprits éthérés ont le réflexe syndical
L’Université de Lausanne n’y va pas de main morte: son équipe Créa «montre« que le tiers de milliard mis par le Canton dans son UniL «génère» plus d’un milliard et demi sonnant et trébuchant; la Fondation pour Genève – épaulée par la Haute école de gestion et ses sœurs – s’est livrée en gros au même jeu: son analyse de la Genève Internationale – commerciale et humanitaire – ne multiplie pas chaque pain par cinq, mais elle montre aussi des milliards de profits «induits». C’est surtout les trois quarts de milliard donnés par la Ville, le Canton et la Confédération à la Genève humanitaire qui devaient se dédouaner par leurs «retombées« et autres «externalités» positives (à noter que le secteur des salons et congrès n’est pas couvert par lesdites «études«).
On ne peut ici en une page défier les près de cent cinquante pages de la Haute école de gestion: nul doute, la diplomatie comme l’éducation est «riche» d’emplois et d’impôts quoi qu’ils «coûtent; quand à la «valeur ajoutée» par la qualité et l’utilité, peut-on la chiffrer de manière aussi péremptoire – et parfois au pour-cent près – comme le font les «chercheurs scientifiques»? On va ici poser des questions plus enfantines que scientifiques, mais auxquelles les cent cinquante pages de calculs auront de la peine à répondre. L’enfant n’a d’ailleurs qu’à écouter les rois savants pour trouver ses questions, comme la semaine passée à une séance de la Banque Mondiale à la Maison de la paix. A coups de graphes chiffrés, on y a montré qu’éducation et prospérité étaient «liées»; mais les grands profs ont eu du mal à dire dans quel sens.
Car le lien causal en faveur de l’école est une notion du XIXe siècle tenue en échec au XXIe: les pays riches sont très diplômés, mais les pays qui croissent le sont peu; où est la cause et où est l’effet? Ce qui – d’une pierre deux coups – mine sans le savoir le «rapport» de l’Université de Lausanne: plus on est diplômé, plus le salaire est haut, y lit-on; mais si le salaire gâte l’employé, est-il pour le patron – et surtout pour l’industrie – un profit ou un coût? Cela fait un demi-siècle que les illettrés du Sud battent les docteurs du Nord, et on est chaque fois surpris qu’ils ne restent pas dans les produits primaires: ils ont de bons emplois mais de piètres salaires.
Un conflit insoluble: celui
d’intérêts
Ces notions à double tranchant, on les retrouve partout; du moins dans le secteur «non lucratif«, car dans l’industrie, on sait que toute «dépense» n’est pas d’emblée un «investissement». Quant aux «recettes» fiscales, c’est le point de vue de l’Administration: pour le contribuable, le fisc est une «charge», et c’est l’enjeu central de la démocratie de faire de cette charge «personnelle» un bienfait pour la «collectivité«. D’ailleurs, si les invisibles mais substantiels bienfaits, profits, bénéfices allaient «sans dire», ce n’est pas un tiers de milliard que le Canton de Vaud devrait mettre dans son UniL, mais un tiers de billion: à cinq pains pour le prix d’un, pourquoi s’arrêter en si bonne voie?
Les «chercheurs» d’or de nos laboratoires sont plus forts que ceux de Californie ou d’Alaska: près de deux siècles plus tard, on ne sait pas encore chiffrer la Ruée vers l’Or, qui a rempli les poches du tailleur Levi et des studios Chaplin, mais guère celles des piocheurs ou de la Municipalité. Pourtant, il n’est pas plus aisé de faire le compte des profits induits par la Place des Nations: certes, les touristes qui viennent y prendre un «selfie» ont payé le tram, mais il y a cinq ans, ils ont apporté leurs virus venus de Chine ou d’Italie. Si ce qui se passe au Palais a des «retombées» si rentables, on devrait coter en Bourse la Safi, cette épicerie chic où les diplomates font des achats à longueur de journée. Et si l’Organisation (…) de la santé fermait boutique, les fonctionnaires se retrouveraient-ils au chômage, partiraient-ils sous d’autres cieux, ou se lanceraient-ils dans des activités encore bien plus «bénéfiques» voire «profitables» (comme on l’a vu à la fin des télécoms publics)? C’est le genre de questions que les «retombologues», «extrenalitociens» et «induisticaires» n’aiment pas se poser. D’autant qu’ils sont – dans tous ces «rapports« et toutes ces «études» – juges et partie. Alors il est temps de voir – hors de portée des chiffres – ce que vaut de nos jours la Genève diplomatique et humanitaire face à la solution des conflits: la vraie «valeur» défie le «nombre», même Le Cid savait ça.
L’esprit a-t-il de la matière?
C’est la grande illusion des grands esprits de croire que leurs lubies sont l’étalon de la «science«: Platon voulait une République des savants, Marx énonçait le socialisme «scientifique», et quand de jeunes historiennes de l’UniL viennent expliquer Mai 68 à des vétérans de Cité Seniors au Prieuré, elles martèlent «enfin une vue scientifique». Et les «plaideurs» de la société «civile» ne doutent pas non plus qu’une fois leurs lubies proclamées «droit», la société réelle va faire un bond en avant.
Hélas! comme même Lénine le savait, «les faits sont têtus» et le crédit que le «peuple» fait à ses anges doit un jour être rendu. Bref, malgré les «économistes» d’avant-garde et leurs chiffres qui «révèlent» des vérités cachées, l’Histoire est une chaîne de vues contraires. Alors, entre ceux qui voient dans le système onusien notre dernier espoir et ceux qui y trouvent une coquille vide, ce n’est pas la Haute école de gestion qui peut trancher avec ses chiffres. Et ceux qui – dans la société plutôt incivile – ont vécu le dilemme face au communisme ne savent trop quel parti prendre. Georges Marchais à l’époque et sous le feu des tardives critiques, avait déclaré le bilan de l’Union soviétique «globalement positif»; Régis Debray – le camarade d’armes de Guevara – s’est lui défroqué. D’accord, les Nations Unies ne sont pas un système de parti unique, mais la rhétorique, la hiérarchie et l’enfermement y sont assez «soviétiques«. Certes, on ne peut rendre le Palais des Nations coupable du regain de guerre malgré l’éducation de paix et la chute d’un certain nombre de dictateurs, mais comment ne pas voir que chaque nouveau «droit» consensuel est aussi d’emblée une «pomme de discorde»?
Le droit à la santé ne tranche pas entre pro et anti vaccin… celui à la durabilité a ses pro et anti nucléaires, celui sur la laïcité conforte tant les pro que les anti foulard, toutes bonnes causes qui «génèrent» de la haine «induite». Même les pneus ou le bruit se discutent chaque jour depuis trois quarts de siècle en petit comité, sans grande valeur ajoutée. On pense à ce dessin animé où le chien, le chat et le rat signent un pacte de paix et le fêtent avec une tranche de viande: faut-il la partager en trois parts égales ou selon la taille de la bête? Et la guerre reprend de plus belle!
L’armée est le seul acteur social à unir tous contre elle: on la tient pour un coût dur sans profit induit… mais même là de nos jours, on doit bien douter, dans des sens divers selon qu’on soit de Moscou ou de Kiev, de Barcelone ou de Strasbourg (et même là: en 2025 ou en 1914?).
Vérité en-deçà de l’Atlantique…
Face à tous ces doutes qui ne pèsent pas lourd mais pas moins que les chiffres des «études» de commande, le soussigné s’est posé soudain la question: «Suis-je seul au monde à ne pas croire?», et il a mis en ligne les mots clefs pour le savoir. Ô surprise, un texte prêt à citer s’est mis d’emblée à l’écran (lactualite.com/lactualite-affaires/lillusion-des-retombees-economiques/). «Le concept même des retombées a peu de sens pour nombre d’économistes», en particulier pour ceux – aux titres assez nobles – cités dans ledit article. S’ensuit une mise en pièce – à coups de cas précis sous la plume d’experts de haut vol – du concept même qui ne profite «qu’aux auteurs« qui valent de l’or… pour eux-mêmes; l’article conclut que ce concept «absurde« sert «surtout à justifier des dépenses très difficiles à vendre autrement».
On peut rejeter les thèses de cet article venu du Québec, mais peut-on refuser d’écouter ces dissidents, sinon de les convier au débat? A propos, les pouvoirs publics ne mènent-ils pas ces jours une campagne d’information «Gare aux rendements mirifiques»? Et l’Académie des sciences n’a-t-elle pas classé depuis des lustres comme «non scientifique» le perpetuum mobile? Les «fake news» les plus trompeuses sont celles qui trompent leurs propres auteurs, aveuglés par l’éclat de leur science.