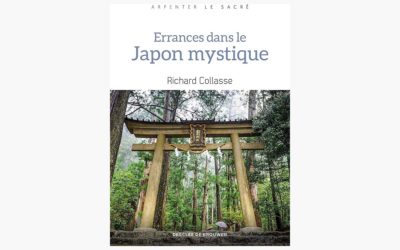hors champ
Où trouver la bonne question?
«Vous n’aviez donc pas vu le coup venir? Il n’a jamais caché ce qu’il ferait!»: on parlait – au Club de la presse – du coup bas de Trump contre «l’aide». A la question venue de la salle – celle d’un journaliste américain proche du «Courrier» et qui d’habitude se lâche contre Wall Street – la patronne de Terre des hommes au podium a répondu avec candeur: «Comment le prévoir? Pendant un demi-siècle, Washington a donné sans compter». Mais on peut changer de question pour voir les choses dans l’autre sens: «La Genève Internationale n’est-elle qu’une coquille vide?». Sans doute oui, mais on trouve encore de quoi se nourrir avec les miettes au sol. Pour les trouver, là aussi on doit poser la bonne question…
Ce printemps, le Monde bégaie: après les tables rondes au Club de la presse ou à la Maison de la paix sur les méfaits de l’équipe Trump, on a eu deux débats en un jour à Uni-Mail: l’un – par un groupe «Altruisme efficace» – sur le devoir d’aider son prochain (surtout au Sud qui souffre tant); l’autre, par le groupe «noir» (mais très ouvert) Kamaf, sur les méfaits du «sauveur blanc» drapé d’«aide». Question pour rire: les décoloniaux et les trumpistes se rejoignent-ils?
Chaque substance pire que
«les substances»?
Assez d’ironie: dans le quartier des Nations ces temps, deux bonnes causes avancent encore par bon vent sans trop de lyrisme. Mais masquées derrière des acronymes mystérieux: en grosses lettres sur le Centre de conférences, «BRS COPs»! Le sujet, pourtant, devrait toucher non juste les experts payés pour, mais tous les acteurs de la santé et du climat. «BRS» sont les initiales des trois villes où furent signées des conventions sur les produits chimiques polluants, et «COP», c’est «Conference of parties» qui se tient tous les deux ans pour mettre à jour les listes (brsmeas.org). Pas facile d’avoir le badge, mais une fois obtenu, on entre dans toutes les questions de chimie oubliées depuis l’école. Certes, chaque jour on nous dit que telle substance est «cancérigène» et on se dit alors que le danger est conjuré. Mais il n’est pas passager quand ladite substance est «éternelle»: qui ne se dégrade pas et donc pollue peu à peu toute la Terre. En fait, combien de types de molécules organiques la nature recèle-t-elle… et combien d’autres sont-elles produites de main d’homme?
Inventeur génial ou apprenti
sorcier?
Personne n’a de réponse certaine à ces questions, mais depuis un siècle que l’industrie fait de la «chimie organique», une cinquantaine de millions de composés ont été inventés (à quoi on peut ajouter des éléments minéraux comme le plomb, innocent pour le courant mais sournois dans les laques): certains sont des gaz dans les frigos ou des mousses chez les pompiers, d’autres couvrent les poêles à frire ou terrassent les limaces, d’autres encore entrent dans les ordis ou les habits… et s’ils sont fluides, gare à l’air et à l’eau. Une fois le danger révélé, on doit les interdire, puis localiser les résidus, mettre la main dessus et s’en défaire (malgré les fraudeurs). «Etre au fait, c’est une course-poursuite; alors on pousse tous les milieux à ouvrir l’œil».
Attaquer le «public» est moins rentable?
Le soir d’ouverture du congrès, un film militant mettait toute la faute sur la compagnie «3M» qui – au tournant du siècle – tuait en silence par ses plastiques d’emballage ou ses liquides contre le feu. Et qui a caché les effets nocifs, connus de ses propres chercheurs. Mais là, une question cruciale manquait: et les agences publiques de contrôle (comme la Food and drug administration), n’était-ce pas à elles à faire le boulot? Et ces produits ne servent-ils qu’à donner le cancer aux peuples indigènes – comme le montre le film pour prendre dix milliards à 3M – ou sont-ils tout de même utiles? Chaque décennie, l’incendie fait un à deux millions de morts, qui émeuvent peu les médias ou les militants (les Russes restent indulgents, même envers l’amiante).
Voilà donc pour les questions les plus enfantines que se pose le journaliste au bout de quelques heures dans le milieu. On peut encore en ajouter une: que cherchent les chercheurs en «sciences de l’environnement» – munis de leurs spectromètres à «voir l’invisible» – depuis trente ans, si on nage encore à ce point dans le flou?
Quand le slogan cache la question
Autre jour, autre sujet, mais encore dans la santé: Journée mondiale contre la malaria, avec une table ronde de l’Agence de la francophonie avec la fondation Find (et la caution de l’OMS qui vaut mieux que ce qu’on dit mais patine sur une science qui fond). Au podium pendant deux heures, diplomates et experts roulent un peu les mécaniques. Mais à la fin, reste une question: pourquoi a-t-on pu «mettre à mort» la variole, la rage, la polio, la peste, même la Covid… alors que la malaria tue encore près d’un million de fois chaque année? Là, on découvre que comparaison n’est pas raison, et que le cycle du parasite entre l’eau, le moustique et l’humain n’est pas aussi facile à combattre qu’un chien enragé… ni même qu’une puce à rat.
Jadis, on drainait les marais et on mettait du pesticide à tout vent… mais de nos jours, on doit ménager trois besoins contraires (les moustiquaires imprégnées sont de nos jours une réponse qui marche à peu de frais). Enfin, comment compte-t-on les morts du paludisme, quand des millions de gens «vivent avec» avant de «mourir de»?
L’argent des autres a-t-il moins d’odeur?
Retour aux bienfaits de l’aide au Sud et aux illusions de la Genève Internationale qui croit à son génie, mais vit en lévitation. Les champions du marathon sont souvent les premiers à rater les virages ou à sauter dans le vide. «Finir comme la Société des Nations? Non, ça ne peut arriver aux Nations Unies», disait jadis le patron du Palais – Michael Møller, pourtant un des plus lucides – quand on lui posait la question. En une autre occasion, un chef de comm’ du Palais excédé sortait son arme choc: «Pouvez-vous imaginer un monde sans les Nations Unies?». Pourquoi pas, car on a eu la même question jadis pour défendre les Télécom (et même la Télévision) d’Etat; mais le Web n’eût pu prendre son essor si on n’avait pas tiré la prise du système officiel. En suivant les débats au Palais des Nations, au Club de la presse ou à la Maison de la paix ces temps, on est partagé: certes, Trump c’est Attila et Ubu tout en un… mais nos esprits éclairés ne prennent pas le temps de le prouver. «Y aurait-il un seul prof plutôt pro-Trump dans notre Institut? Si oui, il n’ose pas le dire!».
Ultime question pour cette fois: à l’origine, les associations reposaient sur l’engagement de citoyens; comment se fait-il que de nos jours, leur personnel vive surtout de la manne publique? Si baroques soient-ils, le Rotary et le Lions donnent plus qu’ils ne prennent: est-ce pour cela qu’on les traite de «réacs»?
Boris engelson
PS: Si vous croisez une molécule organique, avant de lui sauter dessus pour la mettre au bûcher, demandez-lui son nom: si elle répond «protéine», «amidon», «cellulose», «oméga»… elle peut être utile aux êtres vivants; mais si elle dit «fluoride alkylée», gare aux hormones.