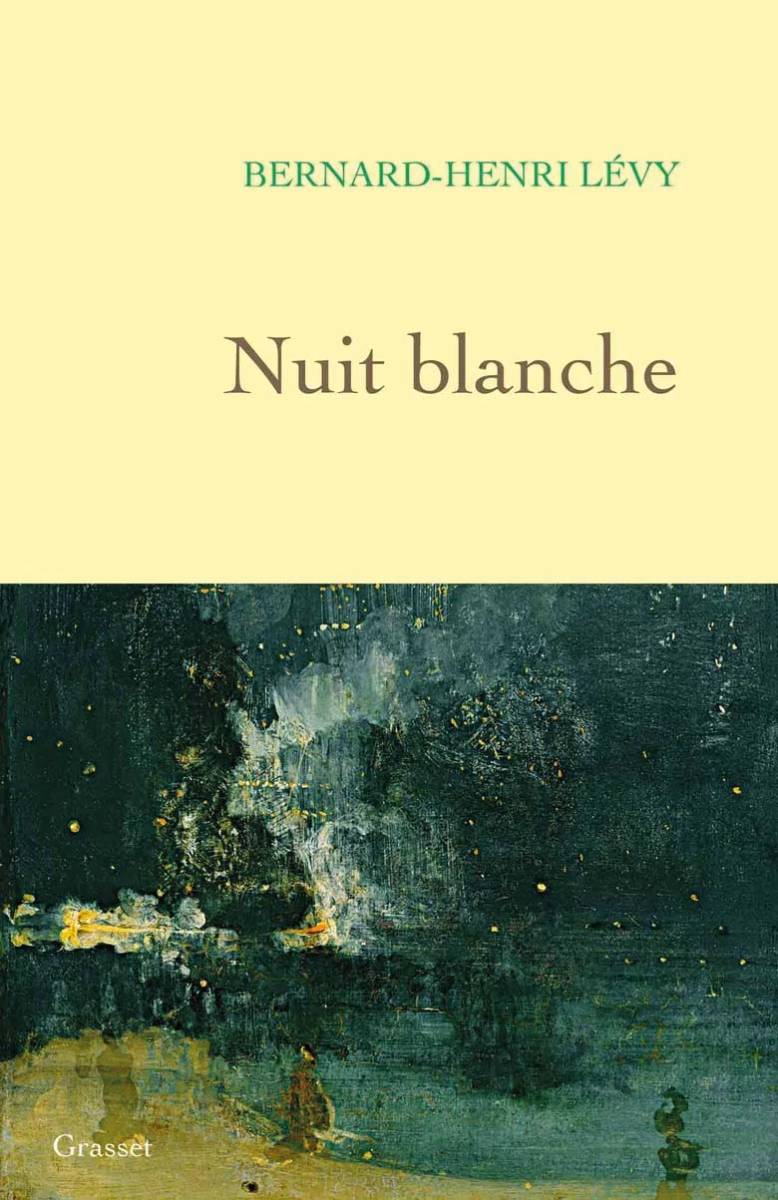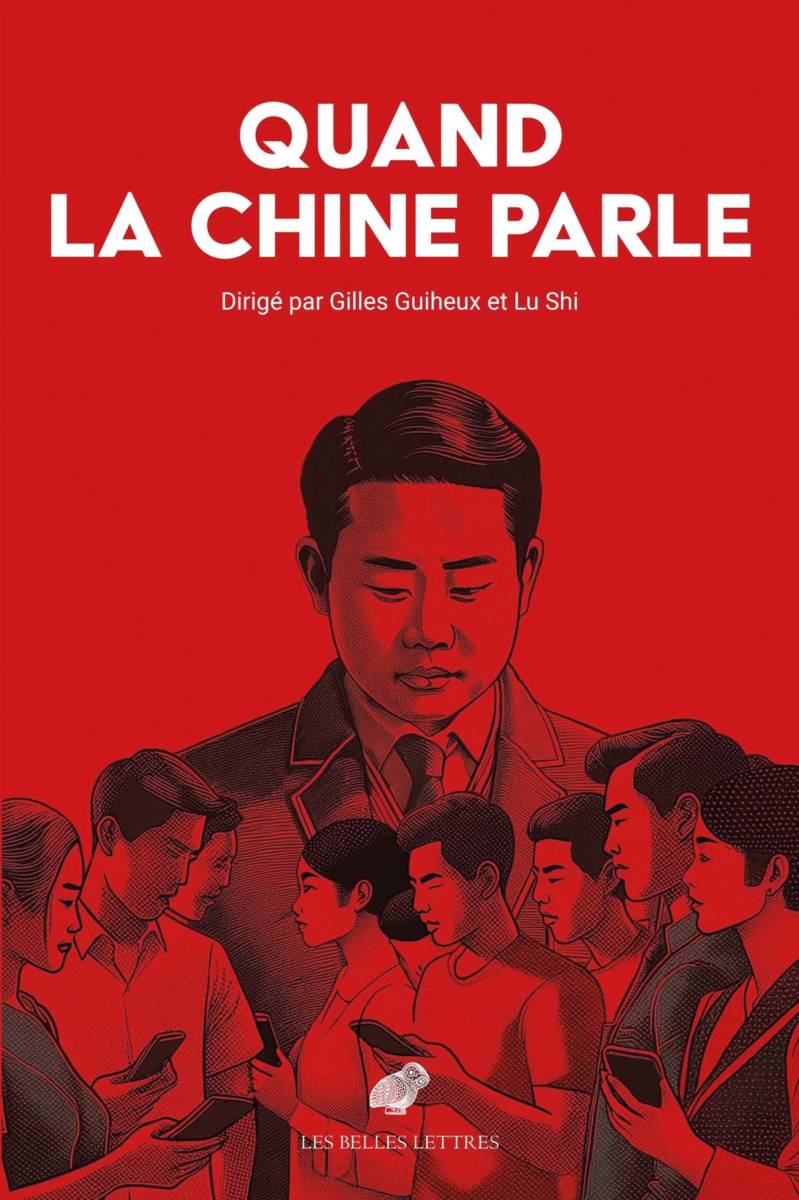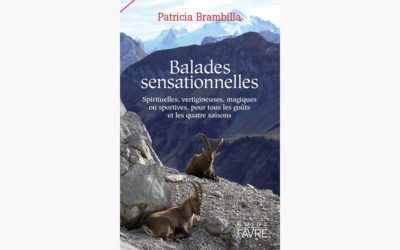Un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal!
/
lectures
Pour les longues soirées d’hiver au coin du feu….
Une nuit blanche avec Bernard-Henry, les expressions qui racontent la Chine, pays en pleine mutation: deux délicieux ouvrages à découvrir…
Nuit blanche
De quoi parle-t-il dans ce livre? Il parle un peu de tout, s’égare ici et là, se promène dans sa chambre, se balade dans ses livres. Bernard-Henri Lévy est insomniaque et il explore, dans ce petit récit sensible et surprenant, doucement mélancolique mais passionnément vivant, cette interminable nuit blanche que devient, le soir venu, sa vie par ailleurs trépidante dès que le jour se lève, nourrie par ses grands reportages, ses prises de position aussi tonitruantes que contestables, ses livres, ses chroniques, ses films.
L’insomnie aiguise-t-elle ou amoindrit-elle la lucidité? Stimule-t-elle ou engourdit-elle les neurones, les vibrations, les envies, les relations aux autres, le sentiment même de l’existence? BHL s’observe et s’analyse «en situation», comme disait son idole Jean-Paul Sartre, c’est-à-dire dans ce monde structuré et puissant de la ville, avec des voisins, des passants, des riverains. Il y a d’abord, en pleine nuit, tous ces bruits qui résonnent, tout ce monde de bruits qui constitue presque, à lui seul, une catégorie philosophique: «Ce bourdon. Ce fracas de bielles. L’arrivée de la benne à ordures (…) Le ricanement des murs, en carton pâte comme chez Kafka. Ces mots chuchotés, criés, murmurés à nouveau, viens mon amour, viens, je t’en prie, je suis revenue, toi aussi, on ne se quittera plus. Et ce râle. Et cet aboi dans le lointain».
Il y a aussi pour BHL, au plus profond de la ville, le sentiment aigu du temps qui s’écoule heure par heure, minute par minute, comme une sorte de mystère, et il y a surtout le sentiment du temps qui a passé, les souvenirs qui reviennent à la pensée d’une rue ou d’un café, les images toujours un peu trop fortes qui s’enfuient quelquefois, mais ne s’apaisent jamais. La violence et la douceur du monde, l’impermanence, l’alternance, les logements qui se suivent et créent une danse banale sous une lumière blafarde. BHL ne dort pas et il se voit, où qu’il soit, «errant dans cet appartement que j’aime mais que je confonds souvent avec le précédent, et le précédent encore, et d’autres, j’ai déménagé si souvent!»
L’écrivain a vendu l’appartement que lui avait offert son père, il est un rat des villes ou plutôt d’une seule ville – Paris -, il rêve de faire l’histoire et il l’a faite parfois, en Bosnie, en Libye, en Ukraine, jamais pour le meilleur et toujours pour le pire… Sa nuit blanche tourne en rond, indéchiffrable, obscure.
Nuit blanche,
par Bernard-Henri Lévy, Edition Grasset.
Quand la Chine parle
«Que dit la langue de l’état d’un pays?» Que disent les mots qui émergent et les mots qui s’éloignent avant de disparaître? Comment les mots nouveaux et les mots engloutis permettent-ils de saisir les grands changements, voire les bouleversements, qui traversent un pays? Ce sont les questions posées par Gilles Guiheux et Lu Shi, deux spécialistes de la Chine qui ont rassemblé autour d’eux d’autres experts du pays pour ce livre passionnant.
«Les expressions étudiées, expliquent-ils, racontent une société en pleine mutation, complexe, traversée de contradictions et de tensions, et intensément connectée au reste du monde. Certaines sont produites par l’Etat-Parti et se diffusent verticalement du haut vers le bas. D’autres sont forgées par les citoyens ordinaires et apparaissent au sein de communautés sur Internet avant de se diffuser largement parmi plus d’un milliard de locuteurs».
Les mots qui bougent rendent compte, en fait, de toute la vie actuelle de cet immense empire: la vie quotidienne, l’organisation du travail, l’éducation des enfants, les pratiques culturelles et sportives, les problèmes de santé, les identités sociales, le contrôle politique, les déplacements entre les campagnes et les villes. C’est sans aucun doute dans le domaine de l’habitat et de l’aménagement, de l’immobilier et de l’architecture, que les expressions nouvelles se sont multipliées: les campagnes ont subi un choc terrible en voyant fuir une grande partie de leur population, tandis que les villes ont littéralement explosé, saisies par une rage de construire et un dynamisme uniques dans l’histoire du monde.
La Chine ne vit plus heureusement au rythme du maoïsme et c’est tout son vocabulaire qui a changé du tout au tout: on ne parle plus des communes populaires, mais du phénomène de démolition-relogement (chaiqian), à savoir les problèmes des résidents, souvent propriétaires de leur appartement, jetés hors de chez eux par la force de la loi ou de la corruption. On parle aussi du phénomène des villages urbains (chengzhongcun), c’est-à-dire de ces quartiers entiers qui se retrouvent un beau jour, presque du jour au lendemain, encerclés de tous les côtés par des forêts de gratte-ciel.
Notons aussi, sur le plan de l’immobilier, l’apparition des appartements d’éducation (xuequfang), un terme qui désigne «les appartements qui permettent d’accéder à des établissements scolaires considérés comme excellents».
Dans cette Chine devenue ultracompétitive, où l’éducation des enfants est devenue la priorité absolue des parents et même des grands-parents et des clans familiaux, les appartements d’éducation surpassent toutes les autres urgences. Jadis propriétés des entreprises publiques, ces appartements sont généralement vétustes et mal entretenus mais idéalement situés au centre-ville, à proximité des écoles les plus réputées. Utilisé à partir des années 2000 par les agents immobiliers, le terme d’appartement d’éducation, expliquent les auteurs, «devient un argument de vente très efficace: la localisation avantageuse pour accéder aux écoles compense la vétusté du bâti. En 2005, lors d’une crise immobilière, les médias soulignent que le prix des appartements d’éducation restent élevés, alors que ceux de l’immobilier classique baissent globalement».
En Chine comme partout ailleurs, l’immobilier, c’est beaucoup plus que l’immobilier! n
Quand la Chine parle,
Ouvrage collectif sous la direction de Gilles Guiheux et Lu Shi, Editions Les Belles lettres.