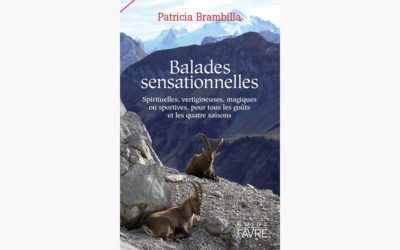SUR LE BOUT DE LA LANGUE
Les mots ont un sens, mais…
«Commémorer», «alternative», «opportunité»: ces mots employés à mauvais escient… Bien souvent, le sens que nous attribuons à tel ou tel terme n’est pas le bon. Mais le phénomène n’est pas spécifique à notre époque.
Que celui qui ne s’est jamais trompé jette la première pierre! Reconnaissons-le: il arrive à chacun d’entre nous d’employer un mot à mauvais escient. Cela n’est pas anormal, d’ailleurs, tant le lexique français est riche. Le «Petit Robert» comme le «Petit Larousse» contiennent chacun environ 65 000 entrées. Impossible de les maîtriser toutes! Et encore, ce ne sont là que des versions abrégées: avec les vocabulaires techniques et les innombrables apports de la francophonie, il n’est pas impossible que le total avoisine le million.
En revanche, il est des erreurs qui s’expliquent autrement. Parfois, on se trompe parce que… l’on se trompe. Voici quelques impairs (et non des impers) à ne pas commettre.
• Commémorer. Un journaliste de Radio France annonça durant l’automne 2021: «Soixante ans après, la France commémorera en 2022 le soixantième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie». Hélas pour le confrère, «commémorer» signifie «marquer par une cérémonie le souvenir d’un événement». Dès lors, de deux choses l’une. Soit on célèbre cette année le soixantième anniversaire de la guerre d’Algérie; soit on commémore la fin de la guerre d’Algérie, survenue voilà soixante ans. En revanche, pour commémorer soixante ans après le soixantième anniversaire de la guerre d’Algérie, il faudra attendre… 2082.
• Alternative. Pour sa rentrée politique 2021, Marine Le Pen assura devant ses troupes en évoquant le duel qu’elle imaginait alors entre elle-même et Emmanuel Macron: «Lors de la présidentielle, il n’y aura que deux alternatives». En réalité, une alternative étant un choix entre deux solutions, sa phrase signifie que les Français devront trancher entre quatre options. Il est vrai qu’à l’époque, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et même Jean-Luc Mélenchon avaient encore l’espoir de se qualifier pour le second tour, mais je ne suis pas certain que telle était l’hypothèse que voulait évoquer la candidate du Rassemblement national…
• Conséquent. Voilà un exemple typique de ce que l’on pourrait appeler une «erreur chic». De plus en plus souvent, «conséquent» remplace le trop banal, «important». «Le poids économique du thermalisme est conséquent», indique ainsi une chaîne de télévision. A cela près que conséquent a une tout autre origine et désigne «ce qui suit logiquement», sens qu’il a d’ailleurs gardé dans «en conséquence». Confondre «conséquent» et «considérable» est donc… inconséquent.
• Opportunité. «Soldes. Profitez des opportunités à saisir». Cette affiche, aperçue sur la devanture d’un magasin parisien, comporte une erreur désormais courante. «Opportunité» est en effet le substantif de l’adjectif «opportun», dont voici la définition: «Qui convient au temps, aux lieux, aux circonstances, qui survient à propos» (Larousse). «Opportunité», utilisé à tort à la place de notre bonne vieille «occasion», est en fait le calque de l’anglais opportunity. Son emploi dans ce sens revêt donc un caractère inopportun.
• Prodigue. Cet adjectif est souvent confondu avec «prodige», auquel il ressemble en effet furieusement. C’est pourtant à tort qu’une vidéo visible sur Dailymotion parlait jadis du retour du footballeur Kylian Mbappé à Bondy comme du retour de «l’enfant prodigue». En réalité, ces deux termes n’ont pas du tout la même signification. «Prodigue» s’applique à une personne qui dépense sans compter, tandis que «prodige» désigne un talent extraordinaire (Mozart fut un enfant prodige). Françoise Sagan, qui atteint la célébrité très tôt et mourut ruinée, fut à la fois prodige et prodigue.
On peut se montrer agacé, évidemment, quand on connaît le sens originel de ces mots. Je ne saurais pourtant terminer cet article sans lancer un appel à l’indulgence en nous souvenant que le français «correct» contemporain se nourrit lui-même de ce type d’évolutions. Je ne serais pas surpris, par exemple, que vous preniez votre «panier» pour acheter des fruits et légumes alors que, stricto sensu, ledit panier était exclusivement réservé au transport du pain. De même, on dit aujourd’hui d’une personne dans un état de tension extrême qu’elle est «énervée», alors qu’à l’origine ce mot désignait un individu privé de nerfs, soit exactement le contraire!
Les linguistes le savent: l’erreur de transmission entre les générations est l’une des principales raisons des changements de sens de notre lexique. «Il arrive en effet souvent que nous ne connaissions qu’une seule des acceptions d’un mot que nos ancêtres utilisaient», note justement André Thibault, professeur à La Sorbonne et spécialiste des variétés du français.
Autrement dit, le propre des langues vivantes est de changer. Toute la difficulté consiste à savoir à quel moment la faute devient la norme…
MICHEL FELTIN-PALAS
Cette chronique de Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef de «L’Express» à Paris, est reproduite avec l’autorisation de l’auteur et du magazine.
©Michel Feltin-Palas/ lexpress.fr/février 2022.