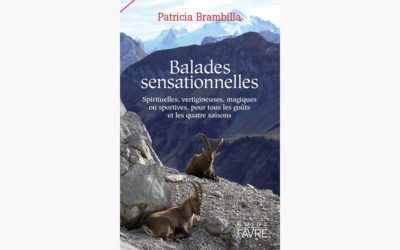hors champ
Les disparus tiennent congrès
«Cette assemblée nous ignore: cela fait des lustres que – dans les territoires occupés – nous souffrons de disparitions, d’exclusion, d’arbitraire…» (cité de mémoire). Ce forum (edworldcongress.org) sortait en tout de l’ordinaire: consacré aux oubliés, on y a entendu moins d’officiels faisant leur numéro que de meurtris criant leur douleur. Et même des minoritaires dans cette minorité – on vient d’en citer une – qui se sont plaint(e)s à leur tour d’être oublié(e)s. D’ailleurs, les «territoires occupés» qu’on vient d’évoquer n’étaient pas ceux qu’on croit…
Ces «disparitions», il y en a de tous types et de tous pays: des gens sans doute assassinés – par des juntes militaires, des milices politiques ou des cartels criminels – mais dont les proches n’ont jamais su au juste ce qu’ils avaient subi. A quoi s’ajoutent – même hors d’une mise à mort – les arrestations arbitraires, les déportations et mises au secret, sans que l’Etat l’admette au grand jour ni informe les familles. Les parents vivent pendant des lustres dans l’espoir ou le chagrin, sans pouvoir pointer du doigt le coupable. Ce fut jadis le titre d’un film d’Alain Resnais et d’une chanson de Jean Ferrat «Nuit et brouillard», citation d’une directive du régime nazi qui voulait laisser le crime dans le flou.
Michelle Bachelet deux
fois disparue
Certains diront «A quoi bon?» vivre dans le souvenir et mettre toutes ses forces à le cultiver une vie durant? Mais pour les proches, oublier serait de la trahison; hasard du calendrier, un film montré au festival Black Movie fin janvier raconte comment une famille de Tanzanie tente de retrouver (après plus d’un siècle), non le corps d’un ancêtre exécuté, mais sa tête, emportée à Berlin par des «savants». C’est aussi – au Panama il y a un demi-siècle – ce qui a tué de chagrin le père de Hugo Spadafora, dont seul le corps décapité par les sbires de Manuel Noriega fut retrouvé. On se rappelle aussi le cas du journaliste Jamal Khashoggi, jamais ressorti d’un consulat d’Arabie Séoudite et dont le sort fut révélé contre toute attente par la police turque. Mais les «Madres de Plaza de Mayo» à Buenos-Aires – qui se sont rencontrées chaque semaine pendant des décennies – illustrent les cas les plus courants. On pense aussi à tous les «Etats voyous» qui n’ont de compte à rendre ni aux juges, ni aux médias… même si c’est moins aisé à l’ère des «réseaux sociaux»; et aux disparus de la photo, comme Léon Trotski et Michelle Bachelet, sinon Amadou-Mahtar M’Bow, passés aux oubliettes de l’Histoire.
Des disparus en poupées russes
Certes, au XXe siècle, des disparus de toute sorte se sont comptés par millions, et souvent en temps de guerre, identifier les corps est une gageure. Et au XXIe, on ne peut être sûr de rien, même à Genève: avec des milliers de sans-papiers, qui va signaler qu’Untel a été zigouillé et enterré en catimini par ses ennemis? Et combien de gens ont-ils été balancés d’un bateau par des passeurs, ou combien de bébés volés à leur mère en contexte trouble (mais là, la victime est plus la mère que le bébé)? Bien sûr, tous ces drames ont suscité aux Nations Unies des «Conventions» assorties d’un Comité et d’une Journée; mais – dès les premiers articles – elles sonnent plus comme des incantations que comme de la juridiction. En gros, lesdites disparitions sont «une atteinte à la dignité humaine» inadmissible même en cas de guerre ou de troubles (en outre, une «Résolution» onusienne établit un «droit à la vérité»). Lueur d’espoir: au congrès de janvier à Genève, on a appris que même à Kaboul, les Talibans n’étaient pas insensibles à l’opinion mondiale (et il y a même des médias critiques sur place!).
Quel angle du triangle a le droit?
Mais retour au début de ce texte: cette dame en pleurs qui parlait du calvaire des siens dans des «territoires occupés» n’était pas de Cisjordanie ni de Gaza, mais du Sahara avalé par le Maroc il y a un demi siècle. Sur les tables dans les couloirs, les papillons d’information accusaient au contraire le camp de Tindouf du Front Polisario. Là, on est dans une guerre d’intox en triangle, entre le Maroc, l’Algérie et un Sahara sans voix même aux Nations Unies (asso.org). Bref, ces apatrides, on ne sait pas trop où les caser, même à un congrès des fantômes qui ne veulent pas baisser les bras.
Pareil pour les Tamouls du Sri Lanka, qui se sont dits un peu oubliés (malgré la présence de Sandya Ekneligoda: veuve – elle préfère dire «épouse» – d’un caricaturiste qui n’en est jamais revenu). Mais les disparus qui ont le moins de défenseurs effectifs – sinon le moins d’amis de leur mémoire – sont les victimes de la criminalité. A-t-on jamais vu la «société civile» mondiale se mobiliser contre les cartels d’Amérique centrale ou d’Asie du Sud et même du Sinaï? Et pas facile de savoir comment s’y prendre: les films sur le Mexique montrés en novembre au festival Filmar trahissaient cet embarras.
La mémoire disparue des médias
Le soussigné l’admet: il n’a pu assister – sur deux jours de congrès – qu’à un bout de plénière et surtout à une séance d’une heure et demi avec Reporters sans Frontières sur la situation des avocats et des journalistes. Deux choses l’ont frappé: aucun journaliste dans la salle, hormis un qui fut jadis lui-même un «disparu» (c’est pourtant rare, un congrès où chaque délégué est un vrai témoin); et le peu d’agents de sécurité en regard des dizaines qui désormais roulent les mécaniques à tout congrès, à chaque colloque, voire au moindre vernissage. Et pourtant, de ce point de vue, tout s’est bien passé.