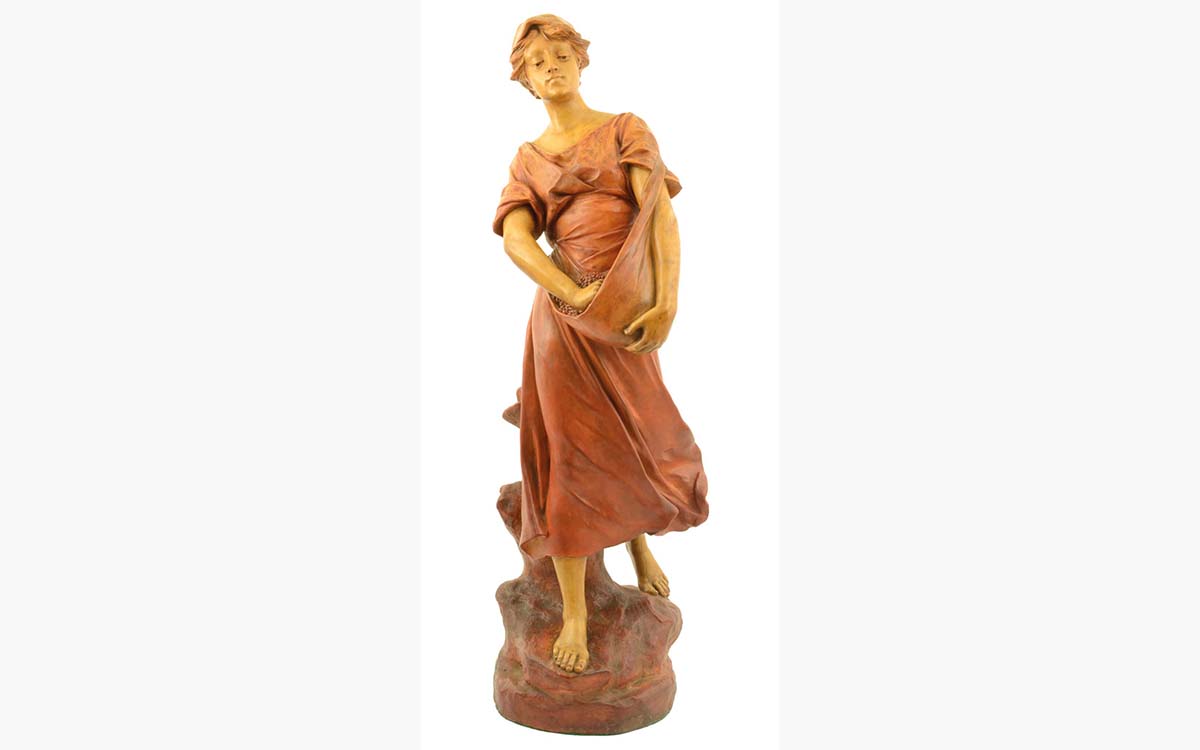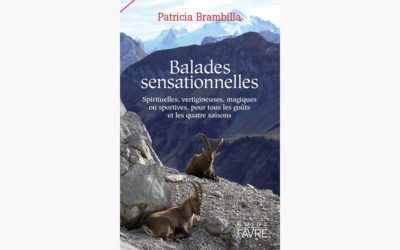hors champ
Et la septième fois, les murailles tombèrent!
«Faire de Genève un pôle international de l’innovation»: depuis au moins six lustres, quelle ville n’a pas à répétition pareille ambition, et la nôtre n’a-t-elle pas déjà six fois sonné trompettes? Mais la Conseillère d’Etat en charge de l’économie n’aime pas se payer de mots: elle reste pieds sur terre et finit par convaincre (au moins à moitié) les plus ironiques.
D’ailleurs, l’ironie était moins celle de la presse que celle du lieu: le face-à-face entre les autorités et les médias – à propos d’un «Plan directeur (…) sur l’innovation» – avait lieu au Campus Biotech, qui a vu tout à tour le déclin des Ateliers de Sécheron, «gloire mondiale» de l’électro-mécanique… de Serono, qui se voulait «la plus grande firme en biotech du monde»… et même du «Projet de recherche européen sur le cerveau». Alors ironie ou non sur les incantations pour l’innovation, Genève commence à voir les effets pervers de sa conversion intégrale à une économie de «services».
Héroïne ou kamikaze?
La menace qui pèse sur la Genève diplomatique – qu’à Zurich, Bâle et Washington on tient pour la capitale des rentiers sinon du «woke» – rend urgentes une diversification, voire une ré-industrialisation. On dira que l’industrie n’a pas totalement déserté Genève, car l’horlogerie de tradition rime pourtant avec mécanique de pointe; et que le CERN ou l’Union (…) des télécom ont les pieds dans la technique sinon les mains dans le cambouis. Enfin, des noms comme LEM et Derendinger font encore briller Genève dans l’électricité ou l’aviation. Mais ce qui fait vivre Genève, c’est surtout la finance, le tourisme et les sièges d’agences onusiennes ou d’entreprises commerciales. Alors, si Delphine Bachmann veut hisser à nouveau le drapeau de l’industrie à Genève, c’est une héroïne qui force l’estime.
Invention antique: le cheval monté
Avant d’évoquer la plus originale des mesures concrètes prévues hic et nunc, jetons un coup d’œil à l’histoire de l’innovation. Les Hittites savaient-ils qu’ils portaient le fer à l’Egypte grâce à une «innovation» métallique? La notion de «progrès» et de «science» dans l’Antiquité est controversée: l’étymologie d’«innovation» renvoie à l’ouverture d’une nouvelle mine ou l’entame d’un nouveau pain. Même la Renaissance n’avait pas conscience d’elle-même au sens que nous lui donnons aujourd’hui. Les «humanités numériques» – dont nos docteurs ès niches tiennent colloque le 7 mars au Musée (…) d’histoire – pourraient nous en dire plus sur les avatars du vocabulaire. Plus près de notre siècle, les Watt, Edison, Boveri, Panhard et Liebig avaient-ils la mystique de «l’innovation» ou juste une passion pour l’électricité, la mécanique et la chimie nouvelles? Et les deux mille brevets de pince à linge déposés depuis 1850 se voulaient-ils «innovation» ou «invention»; et laquelle englobe l’autre? En tout cas, quand j’étais petit, le nec plus ultra de la technique moderne était d’être ingénieur à Sécheron ou aux Charmilles… chez Sulzer ou chez Bull. Certes, le Concours Lépine a été créé en 1901, mais ce n’était au début qu’un salon de jouets. Et si «innovation» est devenu un mot magique aux dépens de la «nouveauté» ou même de l’«invention», on ne met pas si vite le passé hors jeu, comme le disait avec humour le confiseur O. L. Barenton: toute affaire a «(…) un prix, un délai, une qualité… et des habitudes, des sympathies, des influences, des vanités, des espoirs et des craintes… bref, (est tributaire de) tout un passé: il faut tâcher d’avoir le passé pour soi».
Nous sommes nuls mais verts
L’innovation comme obsession de la classe politique est fille de la Seconde ou Troisième révolution industrielle, quand les «Big Blue» à la Thomas J. Watson ont été envoyées au tapis par des «garagistes aux pieds nus» à la Steve Jobs. D’ailleurs, une légende urbaine dit que Hansjörg Wyss – propriétaire du Campus Biotech – a fait sa fortune dans ce mal-nommé «capital risque». Pourquoi donc la Léman Valley n’a jamais pu devenir tout à fait une Silicon Valley, alors qu’elle ne parle que de ça depuis près d’un demi-siècle, c’est sans doute la vraie question. Et pourquoi nos nombreuses officines de soutien aux «start-ups» et nos prestigieuses banques championnes de la gestion de fortune n’ont-elles jamais enrichi de jeunes patrons ni de vieux clients comme l’a fait le «Nasdaq», c’est une question encore plus gênante. Quand nos banquiers privés «construisent des ponts» entre le monde de l’argent et les amis du climat, ils sont sympathiques. Mais les pousser dans cette voie, c’est lâcher le durable réel (une ligne de produits porteurs) pour le durable mythique (les bonnes notes des militants). Le journaliste allemand Jan Fleischhauer avait tenu des propos clairs là-dessus: «Si nos ingénieurs aussi étaient «woke», les Volkswagen auraient des roues carrées» dit-il en substance.
Le volet oublié de la Genève Internationale
Dans la cinquantaine de pages du «Plan directeur», (basé sur les deux cents idées de cinquante experts issues des premières Rencontres de l’innovation tenues il y a un an)
il y a certes bien des redites qui donnent un sentiment de déjà-vu; mais deux pages pourraient bien ouvrir un nouveau chapitre. Le Conseil d’Etat veut créer des synergies entre la Genève savante, diplomatique et commerciale en y intégrant Palexpo et autres lieux de salons et congrès. Il y a de quoi faire, mais ce serait une illusion de croire qu’un organigramme suffirait: rares sont les journalistes ou experts du Palais des Nations et même les chercheurs et professeurs de l’Université, des Hautes écoles ou du Poly à se rendre aux salons et congrès, même quand ils ont lieu juste en face de leur bureau. Et qui a travaillé dans la «science» et l’«humain» sait que les Palais de l’Avenue de la Paix, les Hautes et grandes écoles et même le Campus Biotech sont des paniers de crabes. Pis, les pouvoirs publics, les agences onusiennes et le monde de la communication ont une perception déformée des médias: la presse technique – si fournie aux présentoirs des salons médicaux, horlogers, aériens… – est dans la tache aveugle des services de comm’ et même des projets d’aide aux médias (et certains salons cotés prennent de haut les journalistes qui ne sont pas de la… coterie). Pour faire de Genève un système «innovatif» à synergies «positives», l’interface «science-diplomatie» créé il y a peu ne suffit pas (gesda.global). La meilleure manière de sauver la presse n’est pas de la marier à une diplomatie moribonde ni à un mandarinat scientifique, mais à ce monde encore vivant des salons et congrès: quelle autre ville peut offrir à ses salons un corps de presse comme celui du Palais?
La zone de l’Aéroport doit créer un climat… chaud
Mais même les salons sont menacés de délocalisation par le numérique; alors on va conclure par une suggestion de «nouveauté» sinon d’«innovation. Le Vert Patrice Mugny a nommé Genève «ville de culture»; le Rose Sami Kanaan dit nourrir cette culture; et une candidate Bleue veut faire de Genève une «capitale culturelle». En hiver, quand des milliers de touristes viennent dans les Alpes et doivent parfois trouver une position de repli après-ski, un festival culturel à deux pas de l’Aéroport pourrait créer des synergies au carré, entre la Genève artistique, scientifique, diplomatique, industrielle et… chocolatière.