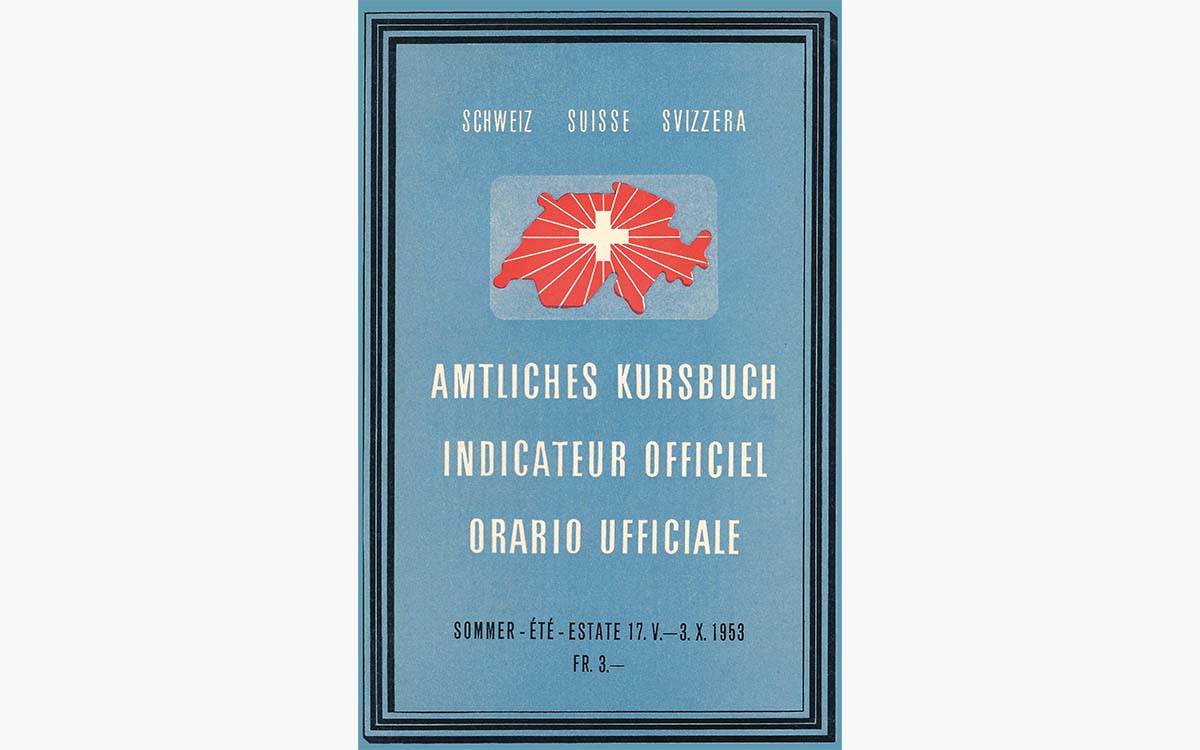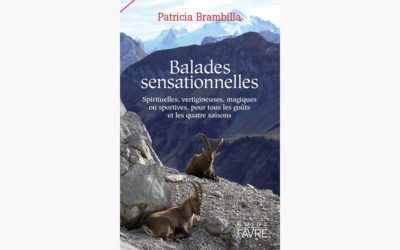hors champ
Ce que n’est pas un journaliste
Le printemps est la saison des «assemblées générales», du moins pour maintes associations médiatiques: Club de la presse, Reporters sans Frontières, Société de radio-télévision, Correspondants au Palais des Nations. Année après année, on y constate que s’il y a un lieu où on ne peut débattre des questions essentielles des médias, c’est bien dans les associations de la branche. Mais si une association de journalistes peut se définir d’abord par ce qu’elle ne fait pas, c’est que le journalisme lui-même ne peut se définir que par ce qu’il n’est pas.
«Ça n’est pas du journalisme!»… «C’est du bon journalisme!»: face à un texte, rédacteurs et lecteurs tomberont plus facilement d’accord quand c’est «mauvais» que quand c’est «valable». Dans cette page, on va donc poser trois questions sans réponse, mais qu’un(e) journaliste doit garder à l’esprit chaque jour: «A quoi sert un(e) journaliste?»; «Pour qui roulent les médias?»; «Un rédacteur est-il un écrivain?».
Qui berne qui?
Arrêt sur image: à quoi reconnaît-on un journaliste dans la foule médiatique? Les visages connus de la télévision sont-ils des pro de l’info, des bêtes de scène ou… de grands commis? Dans la presse, un éditeur n’est pas admis comme journaliste; mais que dire s’il est le créateur et l’unique rédacteur du journal? Et où ranger les bloggeurs bénévoles, les citoyens reporters ou les… hackers en fuites? Les photographes ont obtenu leur label «journaliste» de haute lutte (pour certains d’entre eux, du moins); mais moult pages d’un journal sont écrites – sans un sou ou à prix d’or – par des plumes hors caste sous un autre label: «Tribune libre», «Courrier des lecteurs» ou «Expert invité». Est-on journaliste – ou «communicateur» – quand on écrit dans le journal de la Coop ou de la Migros, de la Fédération patronale, de l’Union syndicale… ou encore dans celui de l’Association des médecins ou de celle des chômeurs? Dans les publications «pro domo» de l’Hôpital, de l’Université, de l’Aéroport, des Transports publics ou des Services industriels, le journaliste n’est-il pas au fond avocat?
La voix du Ciel
Il va de soi qu’un magazine de Pictet et même de la Banque cantonale ou encore d’Amag ou de Novartis porte «la voix de son maître»; mais la neutralité technique de la presse spécialisée fait souvent plus d’intox sans le savoir. Tandis que les revues en papier glacé sont décrites par l’industrie glamour comme «des courroies de transmission».
Au-dessus de la mêlée, sinon de tout soupçon, la presse des organisations internationales ou non gouvernementales; ou encore les bulletins ou radios d’Eglises. Donc, pas facile de dire qui est «légitime» et qui est «abusif» dans le quatrième pouvoir: tout dépend du critère et de l’idée qu’on se fait du «vrai» journalisme. En fin de compte et pendant des lustres, on s’en est tenu à cette définition qui se mord la queue: «Un journaliste est une personne à qui une association de journalistes a accordé une carte de presse».
A quoi répondait un journaliste français, lors d’un débat: «Je refuse par principe d’avoir une carte de presse: elle induit un esprit de corps et des rituels avec le gratin». C’est vrai, les associations professionnelles sont très corporatistes, et la présidente de celle des «professionnels de l’information» s’étonna un jour que les journalistes ne soient pas admis dans la liste.
Populaire en quel sens?
Jadis, les partis politiques avaient une «presse d’opinion» très populaire: on la tenait même pour moins biaisée que la presse «bourgeoise». Le dirait-on encore de nos jours, quand – à l’instar d’un Beat Kappeler qui a quitté l’Union syndicale pour devenir pigiste dans la presse commerciale – Richard Werly a quitté un journal «de qualité» pour un plus «populaire»? Et l’Agence France-Presse, est-elle la voix de l’info libre, ou celle du Quai d’Orsay? Trouve-t-on dans un journal de parti – même solidaire – autre chose que du parti pris? Avec le recul du temps, on apprend aussi que même les meilleurs médias n’étaient pas pour autant sans tache: que de péchés capitaux ont commis «Le Monde» et la «British Broadcasting», voire «Le Canard Enchaîné» et le «New York Times» (même Joseph Pulitzer a fauté)! Le tabou d’un siècle. A l’assemblée générale de l’Association des usagers de la radio-télévision, les ténors de la maison – ceux-là mêmes qu’on retrouve au comité des festivals de cinéma vérité – dictent aux membres (sans le moindre débat) ce qu’ils devront voter! Ce fut tout l’enjeu de No-Billag: de nos jours, le «média public», est-ce celui de monopole fédéral sûr de ses normes, ou l’internet, médium de tous les médias?
Mais où est passée la police?
Est-il vrai qu’on ne parle jamais de ces sujets dans les associations de journalistes? En tout cas, quand on en parle, c’est par un débat pompeux où de grosses huiles du métier, escortés par des experts académiques, viennent asséner leurs clichés: «Le seul bon journalisme, c’est le nôtre; et comme le peuple ne s’en rend plus compte, vive l’aide publique». Et Reporters sans frontières – dont le siège suisse est dans la Tour de la Télé et dont Claude Torracinta fut un maître à penser – s’est fait une règle de ne critiquer que «les autres» en Russie ou au-delà: jamais un mot même sur «l’affaire Ménard».
On dit aussi que les «consciences» du journalisme – comme Antoine Maurice et Daniel Cornu – jugent le «Prix Dumur» – remis avec pompe dans le cadre du Club de la presse – dévoyé par les Marchands du Temple. Le «journalisme d’investigation» à la Tintin est certes un genre noble; mais il est trop souvent un alibi: en Europe, le courage «physique» – s’en prendre à l’ennemi – ne coûte plus grand-chose, alors que le courage moral – critiquer son propre camp – a mauvaise… presse!
Un miroir n’est pas un radar
En France, l’âge d’or des bonnes plumes fut celui où la liberté jouait au chat et à la souris avec le pouvoir (rameutant l’opinion en leur qualité de «publicistes»). Mais quand le «pouvoir» joue avec lui-même, c’est le «conflit d’intérêt»: Richard Nixon – qui écouta aux portes du Watergate – eût mieux fait de s’associer avec Julian Assange, comme Norodom Sihanouk avec «Le Canard Enchaîné».
Ce qui nous ramène à l’autre question du début: à quoi le journaliste est-il bon? Si c’est «à donner de l’information», le Web en déborde, tandis que les agences de presse font faillite; si c’est «à être crédible», les universitaires y ont leur fonds de commerce; si c’est «à mettre à nu les crimes des grands», les victimes sont premières à crier «au voleur!» devant la Justice; si c’est «à rendre les grandes vérités accessibles au petit peuple», les communicateurs s’en disent champions; si c’est «à regarder ailleurs» que vers les poings levés, on a là le rôle du romancier. Mais c’est bien cette question sans réponse qui est la Roche de Sisyphe du journaliste.
Gravé dans le marbre
Pour sortir des deux vallons étroits – celui du chercheur d’arbres qui cachent la forêt et celui du militant qui y enferme ses moutons -, il faut en effet hisser sa conscience lourde au-dessus de la mêlée. Bref et une fois encore, c’est en sentant ce qu’il ne veut pas être que le journaliste trouve son identité.
Qui n’est donc pas juste celle d’un «homme de plume» ou d’une «femme de lettres». D’ailleurs, le journalisme ne se confond pas avec l’écriture, inventée bien avant l’almanach, l’affiche et l’essai. L’écrit servit d’abord de trace officielle aux traités, aux codes, aux contrats, au cadastre, aux annales. La radio, elle, date des bardes et autres griots; avant d’être couchée sur papier d’une Bible ou d’Homère, puis d’être reprise dans les théâtres. Un des premiers cas de censure connus est celui des hiéroglyphes modifiés en faveur d’Hatchépsout.
Mais si – de nos jours encore – on lit «La Guerre du Péloponnèse», c’est que Thucydide est resté comme l’inventeur de l’objectivité: bien qu’Athénien exploitant, il raconta sans parti pris. Tandis que le messager de Marathon fut sans doute le premier à pouvoir se dire à la fois héros et héraut. Mais que mettre sur son épitaphe: «Mort pour réjouir notre ville une heure d’avance, même s’il n’y avait plus urgence»?
Car à défaut de «scoop», la nouvelle eût été de toute façon vite connue, même chez les Perses. Pour cette raison depuis lors, les journalistes jugent plus vital de parler des trains en retard que de ceux à l’heure. L’information exacte à elle seule n’est pas du journalisme: à chaque ligne, le journaliste doit se demander si ce qui est tu n’est pas plus vital que ce qui est dit.