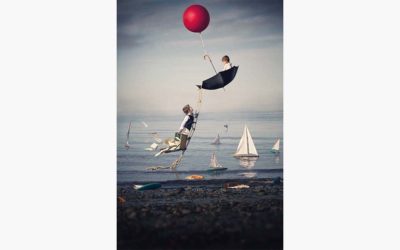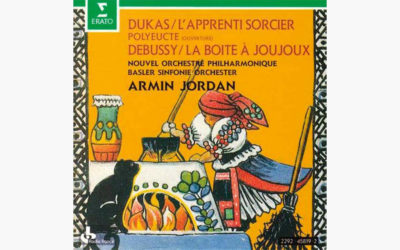carrière & formation
L’éducation défie l’explication
Dans «Spécial Formation», on n’a pas encore trouvé de réponse à la question centrale de la pédagogie: comment rendre tout le monde intelligent sans effort?
Dourtant, des générations d’enseignants s’y sont employés, et désormais «l’intelligence artificielle» ne cesse de crier Eurêka, tandis que l’espoir d’une «pilule» miracle reprend du poil de la bête. Hélas! Plus la science – éducative ou médicale – creuse le sujet à fond, plus il s’avère sans fond: pour être «intelligent», faut-il être «savant» ou l’inverse? Et les gens «intelligents» pensent-ils plus juste que les idiots?
Les mots de passe: les seuls qui comptent
Autre question sans réponse claire: comment les ados font-ils pour écrire leurs textos alors que «les jeunes ne savent plus lire»? Mystère, sauf… osons la question: et si les «sciences de l’éducation» s’étaient gourées sur le haut et le bas? Plus il devient «supérieur», moins le cours est exigeant pour… les profs; plus il est «élémentaire», plus c’est un casse-tête pour les Watson. Jadis, au niveau primaire, une règle pour taper sur les doigts suffisait à faire la leçon, mais de nos jours, les maîtres d’école doivent – comme Figaro – combler les lacunes du ciel et du sol: celles des ministres en haut, celles des familles en bas. Alors que – de plus en plus – l’Alma Mater ne nourrit plus que des «cercles» de clercs qui pensent en rond (bien fermés par des mots de passe «épicènes» et «citoyens» qui tuent dans l’œuf tout débat); bref, pas sûr que les articles savants soient moins primaires que les textos des ados. Bravade gratuite sous couvert de propos abstraits, la critique qu’on vient de brandir? La question est ouverte dans les deux sens: dans Spécial Formation, on a plus d’une fois fait des études détaillées de cas précis sur le savant à l’œuvre (et on y reviendra encore dans les prochains numéros avec des clichés pris dans nos temples du Vrai et du Bien). Pour l’instant, foin de second degré: sautons à pieds joints hors du cercle, dans le tumulte du monde.
La ligne s’impose en ligne
On va se consoler des faux-semblants de l’éducation et de la formation en Europe en voyant ce qui cloche ailleurs; encore faut-il faire sortir de la masse de Google un ou deux textes hors norme. Si on se contente d’un mot clef sans vie, on tombe bien sûr sur la masse de textes ternes de l’officialité éducative. Dont on peut résumer la ligne ainsi… à des variantes près: «La formation transforme la bête en génie, alors ouvrons les vannes sans souci du compteur». A l’inverse, mettre dans Google «Qu’est-ce qui cloche à l’école du Sud» n’est pas non plus la bonne formule pour voir la face cachée de la Lune. Le choix des mots clefs pour garder une question ouverte est sans doute le premier exercice d’esprit critique. Mieux vaut rester un brin neutre tout en nommant la question: «Problèmes éducatifs au Sénégal», «School crisis in Canada», «Que tal las escuaelas en Mexico?»… même timides et classiques, ces mots mettent à nu la déconfiture scolaire aux quatre coins du monde. Et pour être juste, on intercale de temps en temps «succès de la réforme scolaire au Bechmelistan» pour donner une chance aux bonnes nouvelles (brokenchalk.org est une fenêtre ouverte sur les crises scolaires).
Elève à Gaza, un oxymore?
Ce qu’on découvre au fil de ces «recherches» par mot clef n’est pas toujours ce qu’on attend, même si certains marasmes se devinent sans même qu’on aille y voir de plus près. La moitié de l’Afrique est en guerre et une partie de l’Orient vit sous la coupe de clergés religieux ou politiques. Sans oublier que dans le monde entier, la pandémie a cassé net les avancées scolaires, à en croire moult textes officiels. Un peu partout aussi, les progrès de la technique et le déclin de la famille font que le crime a pris un coup de jeune et mine l’école au cœur. Et si au Nord, la formation «de base» se poursuit de préférence pendant une quinzaine voire une vingtaine d’années, le décrochage scolaire inquiète de plus en plus les autorités au Sud. Le Nord n’est toutefois pas épargné par l’absentéisme des élèves; physique quand il se disent malades ou mental quand ils surfent loin du sujet.
Il y a trop de profs
La plus grande surprise – pour le soussigné – fut le paradoxe chinois: moins d’enfants, cela entraîne la fermeture de milliers d’écoles et donc la mise à pied massive de profs. Si la performance éducative est une obsession en Asie de l’Est, la Corée, le Japon, la Chine commencent à déchanter: la surcharge de travail met la jeunesse en état second. Même la Singapour «modèle» est moins classe vue sur place: malgré le film «I am not stupid» qui a secoué le système peu après l’an 2000, le malaise des élèves, des maîtres et des parents subsiste. Et un peu partout, l’école – même quand on la réforme – repose sur des sables mouvants: la motivation des élèves décroît au vu du manque de débouchés qui commence à se faire sentir. Même dans les pays miracles: en Corée, les jeunes se vengent comme ils peuvent, et le corps enseignant voit les suicides se multiplier… ce qui laisse l’Unicef de marbre: elle n’a jamais répondu aux questions du journaliste à ce sujet (quel crédit dès lors accorder à son deux poids-deux mesures lyrique en faveur de l’enfance?).
Plus de Nobel de science
depuis… 1930
On croyait l’Inde temple de la sagesse sinon de l’instruction; mais malgré de gros moyens déployés pour l’école, c’est par dizaines de millions que se comptent les enfants non scolarisés. On dit même que des jeunes femmes sont mariées contre argent et vivent à l’étable entre deux «vêlages». Et la «science» védique du parti au pouvoir étouffe peu à peu l’esprit libre, de l’école primaire aux facs de pointe. Lueur d’espoir: le pédagogue Sugata Mitra – venu jadis parler à l’Ecolint et cité plus d’une fois sous cette plume – avait su tirer le meilleur de la révolution électronique. Dans un village, il avait cloué un ordinateur à un arbre et était repassé un an après: les enfants étaient toujours va-nu-pieds mais tutoyaient des Nobel en ligne.
Avait-il raison ou juste ses raisons?
Autre surprise, aux Philippines, où une saison de pluie et de vent a mis l’école hors jeu pour près de vingt millions d’élèves. En Algérie en quête de grande cause, l’Etat veut fermer les classes en français. Et – pour des raisons qu’elle n’avoue pas – l’Egypte fait la guerre aux écoles pour Soudanais. En Amérique latine – même dans les riches Panama et Costa Rica – les gangs de jeunes font parfois la loi. Et la récession des naissances du Rio Grande à la Terre de Feu y a les mêmes effets qu’entre l’Amour et le Mékong. Au Mexique, le très lettré (ex) président Andres Manuel Lopez Obrador aurait mis à pied cent mille cadres scolaires… mais pour de tout autres raisons.
Exclusif n’est plus très chic
Tombée au Sud sans y penser, l’Australie ces jours se lamente de ses «décennies d’expériences éducatives». Ce qui explique que la réforme scolaire décidée il y a six ans en Indonésie voisine suscite de l’optimisme, certes, mais «prudent». Un des rares pays à pouvoir pavoiser est l’Arabie Saoudite, qui a fait en ce siècle une révolution silencieuse et encore snobée par les «pays avancés». En Russie comme dans bien des pays du chat qui règne et de la souris qui triche, les étudiants fraudent et les enseignants pistonnent. La question de «l’inclusivité» prend dans les Balkans une dimension méconnue: les Roms sont mal traités par l’école, mais la bonne volonté ne suffit pas. Dans un village en Roumanie, une commission paritaire avait concocté une école sur mesure… mais l’Union Européenne y a mis le holà: «Pas d’instruction séparée»! Quant au Groenland, ses écoles ne sont pas aux normes de l’Europe: le statut des mineurs dans des villages isolés aux familles peu sobres n’est pas très «éducatif».
Des questions sans queue ni tête?
Pas facile de tirer des «leçons» de ce tableau composite: quand l’école ne bouge pas, on appelle la réforme; quand elle est passée, on pleure sur les dégâts. Et on doit bien se rendre compte – par exemple avec la baisse du nombre d’enfants – que les «moyens» ne sont pas le seul souci. Surtout, on voit chaque jour, au Nord comme au Sud, que les gens très formés pensent souvent moins que les autres (en particulier ceux qui sont «engagés» pour la bonne cause… termes qui déjà clament leur pensée unique).
Un texte venu du Kosovo le dit en termes très crus: «Notre culture politique nous pousse à chercher des coupables plutôt qu’analyser la vraie mécanique des choses». Mais même ceux qui tentent l’exercice peinent à trouver les liens de cause à effet (surtout en matière scolaire où le tronc commun a souvent fait la nique à ses bonnes intentions; voir Education: un comparatif très instructif des différents systèmes éducatifs européens – www.intercommunalites.fr). Alors entre le titre de cet article et cette conclusion qui se mord la queue, tourner en rond est-ce une fatalité de l’éducation?