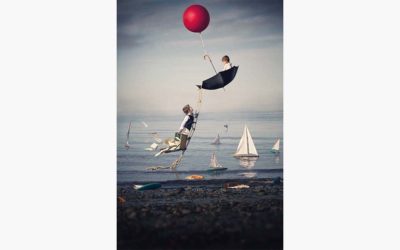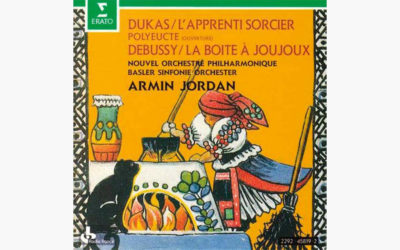carrière & formation
Le travail n’a pas le physique de l’emploi
Chaque année, l’Organisation internationale du travail et le corps de presse du Palais de Nations ont deux ou trois occasions de se parler, sinon de s’entendre: c’est le cas lors du sommet qui réunit toute la tribu en milieu d’année, ou lors de la sortie d’un rapport comme «Emploi et questions sociales dans le monde: tendances», à la veille du Forum de Davos. Mais selon qu’on aime la bonne parole ou qu’on en doute, on lira ledit rapport et on verra ladite tribu d’un autre œil. Ceux qui «aiment» ont intérêt à plonger tout droit dans le site de la maison (ilo.org; voir aussi pressclub.ch:
6 février); ceux qui doutent trouveront plus loin des os à ronger et même du lard à croquer.
C’était la première fois que les médias étaient conviés à l’étage du directeur, avec vue unique sur toute la région; le patron de la maison fut très ouvert aux questions… mais le problème n’est pas là: il est dans l’usure du monde, celui du travail en tout cas, comme on va le voir.
La Palice ne dirait pas mieux
«Le présent rapport met en évidence les principaux goulets d’étranglement qui entravent l’accélération de la transformation structurelle»: ainsi s’annonce le texte de 65 pages (trois fois moins qu’en 2023). On ne va pas ici chipoter sur les termes pompeux, surtout à la fin de la phrase, et on sait que les milieux sociaux rêvent depuis toujours aux «transformations» qu’ils espèrent «accélérées» et plus «structurelles» que superficielles ou passagères. Le travers de ce genre de phrase, c’est qu’à le fin du rapport, on est censé avoir fait un grand pas en avant… sans qu’on sache au juste lequel. D’ailleurs, la leçon à tirer est tout aussi ambiguë: «Le message est clair: la communauté internationale ne peut se contenter de la situation présente» (traduit de l’anglais).
Un recueil de bons mots
Entre l’obscure introduction et la creuse conclusion, y a-t-il au fil du rapport des informations inédites ou des analyses pénétrantes? Certes, on trouve foule de tableaux pleins de chiffres, dont trois sont mis en avant. Un taux mondial moyen de chômage de 5%, qui donc n’a pas empiré ni embelli depuis l’année d’avant; et on peut se demander si un chômeur entretenu par près de vingt actifs, c’est un enfer ou un paradis; si ce sont les dix-neuf en emploi qui doivent cotiser pour le dernier, ils diront que c’est un enfer; si le salut du chômeur est aux frais de l’impôt sur les riches, on dira – c’est implicite dans les conclusions du rapport – que c’est un paradis. Deuxième chiffre clef: une croissance de la productivité de plus en plus chiche à 3% et deux virgules: des livres ont été écrits depuis avant Karl Marx sur cette «baisse tendancielle du taux de profit» – car c’est en gros la même chose – qui prouve l’échec du grand méchant capital. Mais d’autres livres sont encore à écrire sur le pourquoi de l’échec du progrès technique, dont tous les experts ès chiffres portent un bout de responsabilité.
Surtout quand leur rapport parle de situation moins bonne (ou, chez l’ennemi, moins grave) que «prévue»: ils ou elles ne diront jamais «nous nous sommes gouré(e)s» mais «les succès sont moins grands que prévus» (prévus par qui? En tout cas pas par notre rubrique de Cassandre). Le troisième chiffre clef, c’est le milliard de mains (donc demi-milliard de gens) hors travail: chômeurs, découragés, marginalisés (on ne dira pas «marginaux», car dans la religion de l’Organisation – à l’inverse de celle du loup face au chien de la fable – nul n’est hors salaire de son propre choix). De même, le rapport parle de privilégiés «retranchés» et de précaires «piégés», dans un marché du travail «fragmenté» qui les prive d’un emploi «décent». Et pour ne se mettre personne à dos, on se lamente sur les difficultés des jeunes qui peinent à entrer dans le marché de l’emploi, on admet qu’à l’inverse, les seniors ont moins de peine – dans les pays riches, du moins – à être employés… sans qu’on ose évoquer l’épineuse question de l’âge de la retraite.
Le travail social est en
«surproduction»
On a aussi des mots aimables pour les migrants, dont les pays riches ont besoin sans être prêts à en payer le prix, et des diasporas qui peuvent aider leurs malheureux pays d’origine. Mais n’est-ce pas à nouveau le cycle infernal de la dépendance des pays indépendants? Non! car on précise que l’argent de la diaspora doit se recentrer sur des projets «productifs». C’est le terme qui brûle le plus les doigts et la langue, «productif» ou «productivité»: on tient pour acquis que les emplois verts sont productifs comme des pousses de bananiers et donc que la question de leur coût ne se pose pas. Mais quand on demande au directeur général si les employés de sa maison, si les experts de l’ONU, si le corps de presse du Palais… sont «productifs» et comment le juger, il ne répond pas. Gilbert
F. Houngbo – un homme sympa et capable – avait sans doute plus de chance de mettre la main à la pâte quand il était sur le terrain dans son pays, mais la question la plus gênante est ailleurs: s’il devait prendre des décisions comme ministre en Afrique ou comme patron d’Airbus, trouverait-il dans le rapport (de l’Organisation internationale du travail) un fait, un chiffre, une analyse, une prévision… qui lui soit utile?
Il est temps de repartir de zéro
Un pas de plus pour piétiner les gros sabots d’une vache sacrée: le progrès social est-il dû à l’action du Bureau international du travail? A l’origine, peut-être: au sortir de la Première Guerre mondiale, lutter contre la misère ouvrière semblait primordial au maintien de la paix. Quoique la misère dénoncée par Dickens et Zola ait été depuis des lustres battue en brèche non juste par le mouvement socialiste et par ce corporatisme à deux visages qu’on appelle le «syndicalisme» (et dont Jimmy Hoffa fut plus tard l’ambigu symbole), mais aussi par le progrès des transports qui mettaient les employeurs en concurrence, par l’essor des médias qui dénonçaient les abus et informaient les électeurs… voire par la prévoyance des princes comme sous Bismarck. Un siècle après sa création, l’Organisation internationale du travail est plutôt un cartel ou un trio de «partenaires sociaux» qui laissent sur le carreau tous ces «informels» – les trois quarts des «travailleurs» (dont la paysannerie), qui ne sont pas «employés» - qu’elle veut faire disparaître, pour la bonne cause du travail «décent».