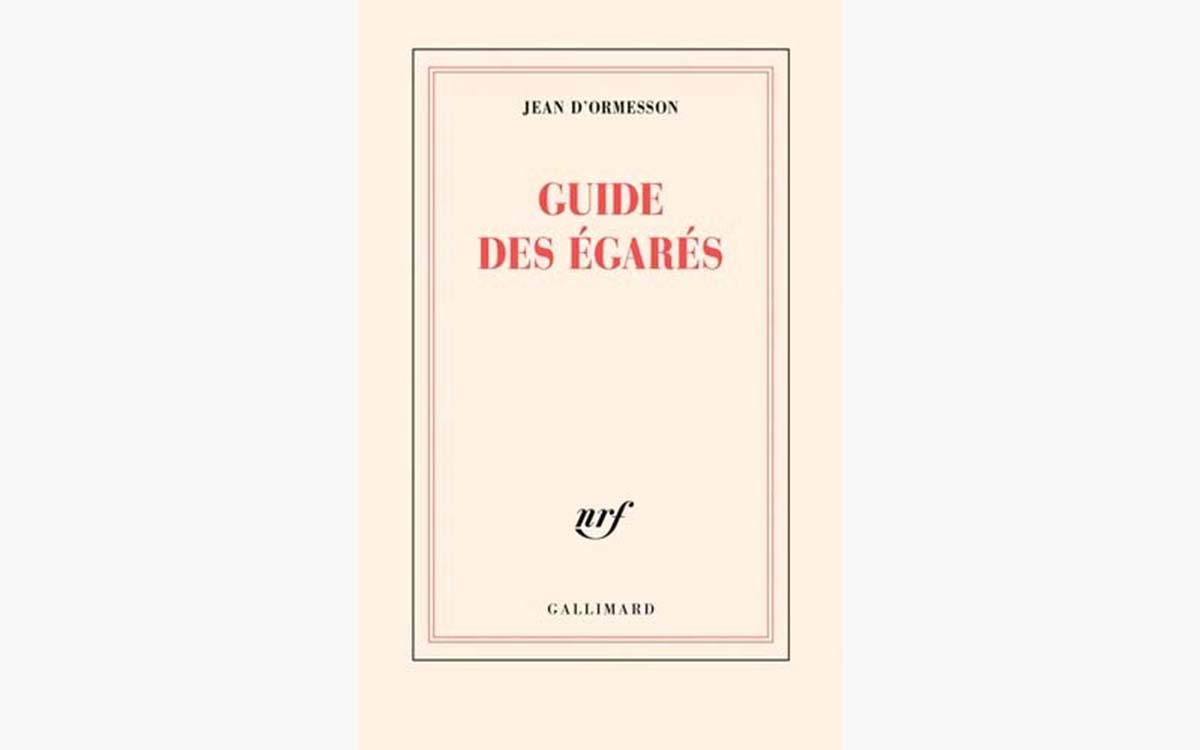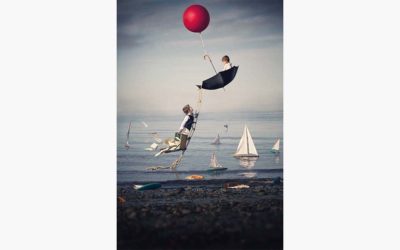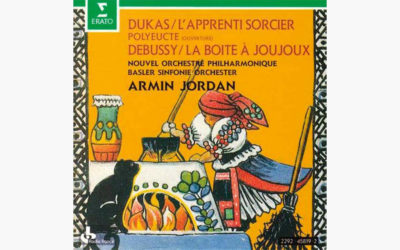carrière & formation
La page noire vaut la blanche
Pour un jeune qui rêve d’être le nouveau Balzac, la première page est la plus dure à remplir. A un adulte dans les médias, c’est plutôt la page noire qui fait peur. Surtout quand – tout au long du mois aux quatre coins de la cité – les maîtres ès savoir font la leçon aux égarés. De quoi noircir dix pages d’un «Spécial Formation»… sans remplissage grâce à l’indignation.
Depuis le dernier Spécial, les occasions d’apprendre n’ont pas manqué à Genève. Toutes ne furent pas scolaires, mais nombre nous dirent que penser (et qu’en faire): Salon du livre, Conseil des droits de l’homme, Journées des films «à impact», soirée à la gloire des «médias de qualité», séminaire du Cern sur «l’esprit critique» (dont seul sait user Metin Arditi face au ballet «art et science»)… On peut d’ailleurs retrouver – en ligne sans l’aide des médias – ces prestations «de haut niveau». Mais ce qui pousse le journaliste à noircir tout de même sa page, c’est le précepte de Stéphane Hessel: «Indignez-vous!».
Hélas! les «indignologues», «indignophiles» et «indignomanes» sont choqués quand ce sont eux ou elles la cause ou la cible d’une indignation. En effet, pour les gens bien et les pros du vrai, le Mal, le Faux – son nom l’indique – n’est que d’un côté. Mais quand le Bien et le Vrai parlent la langue de bois, est-ce mal de s’en indigner? Quelques exemples où l’érudition savante tue le parler-vrai et où l’expert qui juge est aussi partie pour masquer le conflit.
Les psychologues et la repentance
Ces jours, l’Université de Genève fête le
demi-siècle d’âge de sa Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Dans le numéro de Campus (revue de l’Uni) qui le célèbre, guère de recul sur le fond, un vague bémol sur la forme, et pourtant, la «scientificité» de tout ce qui est psy est sujette à caution. La psychanalyse est un champ de ruines, l’école est en crise systémique et le désarroi des colloques en «entrée libre» à Belle-Idée reste «entre-soi». Si bien que les ambitions sont revues à la baisse en catimini: «Le psychologue vous permettra de mettre des mots sur vos maux, de valider vos émotions et vos souffrances», dit un texte savant trouvé en ligne.
Bref, ce n’est qu’en sortant du cadre qu’on ouvre le débat: un cycle «d’art» (voir «Guess my Emotion») à la Maison de l’enfance a permis à une psy de faire part de ses succès et doutes, dans un champ où – faute de mieux – on en revient à la «méditation» et aux «psychédéliques». Bigre, difficile de «Penser contre soi» (titre d’un livre de Nathan Devers, fait sien par Roland Junod) quand il y a une carrière à la clef. Les rois le savaient, qui se gardaient bien de guérir leur fou et allaient parfois masqués au marché entendre la vérité. Certains textes peu connus de Michel Foucault sur la «parrhésie» soulèvent aussi la question; mais les mauvaises langues disent que Foucault était au fond un rebelle d’apparat, plus officiel qu’il y paraît (voir aussi edition.uqam.ca/gree/article/view/935). Curieux: sous (par exemple) «les travers de l’Université», on ne trouve pas grand-chose en ligne; mais en anglais, sous «What’s wrong with Academia», on ouvre les vannes de milliers de propos acerbes de gens qui pleurent sur le temps qu’ils/elles y ont perdu (voir aussi AskAcademia).
Radio-télé scolaire: un pléonasme?
Le corporatisme camouflé en scientificité s’est retrouvé à un symposium (tenu au Campus Biotech) sur la «philanthropie» au service des médias où se donnèrent la main l’Université avec son Centre d’étude de la philanthropie, l’Union européenne de radio-télévision, les Ecoles polytechniques… bref, tout le gratin des «fonctionnaires de la vérité». Plus que la main, elles se donnèrent la parole pour dire du bien l’une l’autre et faire les gros yeux aux médias non adoubés. Un podium de «rentiers», pour reprendre l’aveu d’un prof connu lors de son départ; mais aussi le lapsus du patron de la maison à une soirée à la Tour de la Télé: «Baisser notre redevance, c’est comme tailler dans votre rente!». Mais on doit bien une rente à un média de «service public» si zélé qu’il fut même «plus royaliste que le roi» au récent Festival du film des droits humains (même une experte dans la salle s’en est… indignée). A la journée sur la philanthropie, «Le Temps» fut bien sûr le modèle attitré voire patenté de «média de qualité». A ce propos, voici une anecdote qui vaut son pesant d’or… c’est le cas de le dire.
Une valse à trois temps
Depuis que des journaux ont choisi comme nom «Le Temps», ils ont déçu bien des espoirs: le grand titre d’Entre-deux-guerres a sombré dans la collaboration, hormis Hubert Beuve-Méry (le «Canard Enchaîné» n’a pas fait mieux). Et un autre «Temps» à Rio – nous apprend la «Petite Revue» de 1893 – a péché par machisme «égoïste» et «injuste»: son concours de laideur a rendu millionnaire le gagnant (un paysan veuf de 42 ans); ce qui a suscité un courrier féministe indigné: «Nous aussi avons le droit d’être laides», dirent en gros les outragées de cette chasse gardée. Par contre, les économistes dont on s’est moqué ici il y a deux numéros penseront sans doute: «Millionnaire grâce à sa laideur? Faisons un tel concours chaque jour dans tous les médias… et notre société comptera plus de millionnaires que de mendiants et pourra sauver les médias par la philanthropie».
Emancipation de commande?
Mais trêve d’ironie… l’heure est au Salon du livre: curieux, les maîtres de français n’étaient pas aux «Rendez-vous professionnels» de la littérature, mais les «didacticiennes de la citoyenneté» sont venues «s’engager» au stand du «Courrier» (tandis que les élèves étaient dans la halle). Autant être bon public avant de croiser plus loin le fer: le livre citoyen débattu au «Courrier» fut «Entre éducation engagée et émancipation empêchée»… tout un programme extra mais scolaire. En fait, la profession de foi d’un groupe de croyants de la Faculté, qui ne démode pas pour autant des livres moins «scientifiques» mais plus oniriques, comme «Peut mieux faire» de Leyla Tatzber et «Zohra la Bédouine aveugle» chez Eclectica, qui résistent au temps. Voilà. Le lecteur a le choix, et le soussigné aura enfin laissé parler Leyla et Zohra.