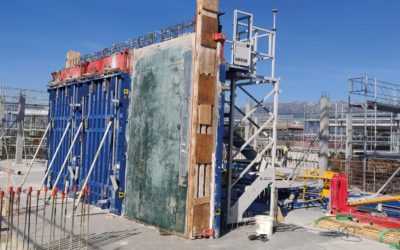économie - Panique sur les marchés
Quand Donald Trump fait trembler l’économie mondiale
Annoncés en avril, les nouveaux droits de douane américains sur les produits importés, en hausse brutale, ont plongé le monde dans la stupeur. C’est tout un monde qui vacille sur ses bases, économiques mais aussi politiques et culturelles. Le moratoire intervenu entre-temps a fait remonter les cours sur presque toutes les places financières, mais la fébrilité demeure.
«Ceci n’est pas une pipe, c’est la représentation d’une pipe», disait le peintre Magritte pour expliquer son plus célèbre tableau. De même ceci – c’est-à-dire les déficits commerciaux, les statistiques, les chiffres… – n’est pas l’économie mais une représentation de l’économie qui n’existe et ne se déploie en réalité que sur un tout autre registre, celui des échanges infinis qui composent la vie des pays et de la vie humaine en général. En augmentant brutalement les droits de douane dont la baisse permanente, voire la quasi-disparition, constituait la base même de la «mondialisation heureuse», sa base intellectuelle et morale, le président amé- ricain Donald Trump a frappé partout à la fois, au portefeuille bien sûr, mais aussi et surtout à la tête et au cœur.
La fin de la vulgate mondialiste
Le sociologue genevois Jean Ziegler le disait depuis longtemps, avec son étrange prescience des vérités qui sautent aux yeux mais que personne ne voit, «l’ultra-libé- ralisme est une religion», et cette religion s’était répandue partout, consciemment mais surtout inconsciemment, dans tous les pays du monde, dans toutes les sphères de la société, tous les courants de pensée, tous les partis de gauche comme de droite, chez tous les intellectuels, les responsables économiques, les entrepreneurs, les syndicalistes… D’où l’espèce de clameur unanimiste et indignée qui a saisi le monde après ce 2 avril décrété «jour de la libération» par Donald Trump, devenu le fossoyeur d’une mondialisation dont on croyait qu’il était le gardien. D’où ce chœur de pleureuses qui ne retombe pas, mais qui campe désormais dans la colère froide.
Tout se passe comme si la fin de l’histoire annoncée par Fukuyama après la chute de l’Union soviétique s’était déjà installée dans l’ADN de nos sociétés, qu’elle était même devenue une espèce de vulgate partagée par tout le monde et qui influençait tout, passée allègrement de son champ d’origine, l’économie, à d’autres champs plus vastes, ceux de la politique et de la société, mais aussi de l’intelligence et de la culture, parfois même de la spiritualité. Obtenue grâce la baisse des tarifs douaniers, la libéralisation des échanges était devenue une vertu et un attribut du camp du Bien, une avancée d’ordre économique annonçant d’autres avancées à venir qui seraient cette fois d’ordre civilisationnel, à savoir l’ouverture des frontières et la fin des Nations, le dialogue des cultures et la biodiversité. Défenseur obstiné de la gauche d’avant, le philosophe français Michel Onfray appelle cela «l’Europe de Maastricht».
Les vainqueurs seront les perdants
Mais tout ceci n’est pas l’économie, aurait pu dire Magritte, mais la représentation de l’économie qui constitue une réalité plus dure et plus brutale, plus insaisissable et largement inextricable. Car on a désormais un vrai capharnaüm devant les yeux, un paysage de désolation annoncée (ou de renaissance promise) qui va dans tous les sens et dont personne ne peut dire de manière certaine comment il va se stabiliser. Pour résumer à l’extrême, la mondialisation a fait deux grands vainqueurs, d’une part les consommateurs américains, puisque les prix des produits importés ont baissé, et, d’autre part, les très grandes entreprises qui se sont retrouvées favorisées par rapport à leurs concurrentes moyennes ou petites par un jeu complexe d’économies d’échelle (Apple produit en Chine et vend depuis l’Irlande, ce qui lui permet d’échapper aux taxes américaines. De fait, les fameux GAFA – et non les pays étrangers – sont les vraies cibles de Trump).
C’est là que réside toute l’ambiguïté: un citoyen américain est à la fois consommateur et producteur: il profite de la baisse des prix des produits importés, mais il risque de perdre son emploi (et son revenu) parce que l’entreprise où il travaille n’arrive pas à soutenir la double concurrence – étrangère et de ses rivales américaines – et qu’elle finit par faire faillite. En augmentant massivement les droits de douane, Donald Trump veut chambouler les règles du jeu, c’est- à-dire les rééquilibrer et les rendre plus justes, et il espère faire revivre ainsi tout ce réseau d’entreprises petites et moyennes à l’agonie qui constitue la véritable industrie américaine. Il veut donc, au sens propre, ré- industrialiser l’Amérique.
La Bourse de Wall Street a chuté violemment, ce qui était normal puisqu’elle héberge en son sein et qu’elle traduit le sentiment des plus grandes sociétés amé- ricaines et internationales, celles qui ont le plus profité de la mondialisation et qui se rendent compte, aujourd’hui, qu’elles risquent d’être les plus heurtées par les mesures de Donald Trump. Mais qu’en est-il à l’échelle de la planète? Qu’en est-il de l’économie de tant de pays totalement différents? Qu’en est-il de la situation des différentes branches économiques, des atouts des uns et des autres? Qu’en est-il des différentes strates fiscales, les droits de douane se mêlant et s’ajoutant allègrement, ici et là, aux divers impôts locaux et nationaux? Qu’en est-il de cette fameuse résilience devenue un mot clef de l’époque actuelle
Annoncées de manière globale et volontairement intimidantes par le président Donald Trump, les nouvelles taxes atteignent, en moyenne, plus de 30 pour cent, avec des taux records et presque invraisemblables pour le Lesotho ou le Vietnam. Mais l’économie est une réalité vivante et les acteurs économiques des êtres doués de réactivité et de raison, des êtres capables de s’adapter à une tempête de taxes comme à un cataclysme politique, par exemple une révolution, ou comme à un fait de nature, par exemple un ouragan ou un tremblement de terre.
L’impératif pour la Suisse: l’imagination
Pays par pays, secteur par secteur, responsable politique par responsable politique, c’est désormais une sorte de tâtonnement général auquel on assiste. L’Europe serait-elle à nouveau aux abonnés absents, incapable de faire face et confinée dans le ressentiment? «Le monde tel qu’on le connaissait a disparu», gémissait l’autre dimanche le premier ministre anglais Keir Starmer, peu après que le président fran- çais Emmanuel Macron, vexé, eut exhorté les entrepreneurs français à suspendre leurs investissements aux Etats-Unis. On fait des mots, on s’épanche, on libère la parole, on parle de «riposte»…
La Suisse n’est pas épargnée par les hausses de taxes, mais elle semble raison garder, sachant que l’amertume n’est pas une politique. Le monde nouveau voulu par Donald Trump sera-t-il forcément aussi terrifiant que les éternels défenseurs du statu quo et des situations acquises veulent le faire croire? Les entreprises ne vont-elles pas s’adapter à de nouvelles règles comme elles le font depuis la nuit des temps? Ces règles seront dures, mais elles auront sans doute aussi, à l’usage, leurs avantages. L’histoire de la Suisse, n’est-ce pas celle d’un petit pays enclavé et isolé, démuni de toute matière première, qui a réussi à devenir un lieu de prospérité et de richesse grâce à son travail et à son imagination?