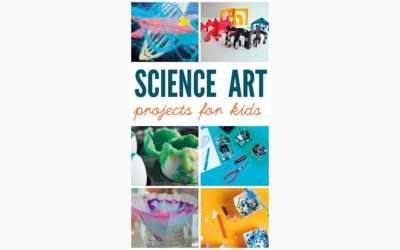sur le BOUT DE LA LANGUE
Nous parlons souvent breton sans le savoir
Dolmen, bijou, cohue… La langue française doit beaucoup à la langue bretonne. Près de 200 mots de notre langue viennent de cet idiome celtique.
Sauriez-vous décrire les liens qui unissent le gaulois et le breton? Peut-être pas, et nul ne saurait vous le reprocher puisque, sauf exception, l’école publique n’aborde jamais ce type de sujets. D’où l’utilité de l’ouvrage très pédagogique et abondamment illustré qu’ont publié Nicolas et Serge Buanic, deux frères passionnés de linguistique (l’un est diplômé de l’Ecole nationale des chartes, l’autre titulaire d’un DEA de l’Ecole des langues orientales), «Les Mots bretons dans la langue française» (Editions Ouest-France).
Or donc, voici. Avant l’arrivée des Romains vivaient dans les territoires qui allaient respectivement devenir la France et la Grande-Bretagne des Celtes qui, c’est logique, parlaient des langues celtiques. (A la notable exception de l’Aquitaine où vivaient non pas des Gaulois mais des « Basques »)..
Plus tard, on appellera Gaulois les Celtes de Gaule et Bretons les Celtes de Grande-Bretagne, sachant que, c’est tout aussi logique, les premiers parlaient le gaulois et les seconds le brittonique – deux variantes de langues celtiques.
Projetons-nous maintenant au Ve siècle, au moment de la chute de l’Empire romain. A cette époque, en France, le gaulois a été supplanté par le latin. En revanche, le brittonique a résisté outre-Manche, où les Romains étaient moins nombreux. A cela près que ces Bretons-là ont dû alors faire face à d’autres envahisseurs, venus des terres germaniques, notamment les Angles et les Saxons. La pression fut si forte qu’une partie des «Bretons» durent émigrer vers la Bretagne actuelle, et ce avec des effectifs tels qu’ils parvinrent à y imposer leur fameux brittonique.
Si vous avez bien suivi, le breton n’est donc pas un descendant direct du gaulois, lequel a disparu corps et biens, mais d’une autre langue celtique – le brittonique, donc – importée sur place par un peuple venu de Grande-Bretagne.
«Dolmen» ou «menhir» ont été adoptés dans un grand nombre de langues étrangères.
Gare au gallo
L’Histoire, toutefois, ne s’arrête jamais. Dans les siècles qui suivent, les Bretons étendirent leur territoire plus à l’Est, jusqu’aux duchés de Nantes et de Rennes. Ils fondèrent un royaume unifié, dans lequel ils diffusèrent leur langue. Avancée éphémère: à mesure que s’affirma le pouvoir du roi de France, le breton recula vers l’Ouest au profit du français, bien sûr, mais aussi d’une autre langue d’oïl: le gallo.
Tout cela signifie que, depuis des siècles, le français est en contact avec le breton et qu’il en est résulté des échanges réguliers, plus riches qu’on ne le croit parfois. Selon les frères Buanic, pas moins de 171 mots venus du breton se seraient ainsi introduits dans notre langue nationale. Il en est de célèbres, tels «bagad», «biniou», «chouchen», «dolmen» ou «menhir» – ces deux derniers ont même été adoptés dans un grand nombre de langues étrangères.
Il en est de moins connus. «Balai» est ainsi issu de balan qui signifie «genêt» (la fabrication de balais de genêts devint une spécialité bretonne dès le Moyen Age). «Bijou» vient de bisou (ou bizou), qui signifie «bague de doigt». «Cohue» provient de koc’hu (ou koc’hui) qui équivaut à «halle». Et bien évidemment, dans la mesure où les Bretons ont toujours été de grands marins devant l’Eternel, on en trouve à foison dans le registre maritime avec «goélette», «bernique» «goémon», «darne» ou «aber».
Il en est enfin de tristement révélateurs, tel «baragouiner», francisation approximative de deux mots bretons: bara, «pain», et gwin, «vin». Même attitude condescendante avec le choix de «plouc» pour désigner un paysan mal dégrossi, vulgaire et sans éducation; un terme directement inspiré des paroisses de Basse-Bretagne commençant par la syllabe «Plou» (Plougourvest, Plougonvelin…). Ce qui, au passage, traduit l’inculture des «Parisiens» puisque ce préfixe est en fait inspiré du latin plebs (qui a donné la «plèbe») pour définir la communauté paroissiale. Notons toutefois que les habitants de la capitale ne sont pas les seuls à se moquer de ceux qui parlent un autre idiome. En breton, l’adjectif gall signifie certes «français» ou «gallo», mais aussi… «bègue». Le mauvais exemple, il est vrai, vient de loin. Les Grecs, déjà, qualifiaient ceux qui ne parlaient pas leur langue de «barbares».
Il n’empêche. Malgré quelques détours, le breton reste bel et bien la seule langue qui nous rattache à notre passé gaulois. Comment mieux dire qu’il appartient au patrimoine national, et que la France serait folle de le laisser disparaître?
MICHEL FELTIN-PALAS
Cette chronique de Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef de «L’Express» à Paris, est reproduite avec l’autorisation de l’auteur et du magazine.
©Michel Feltin-Palas/ lexpress.fr/février 2022.