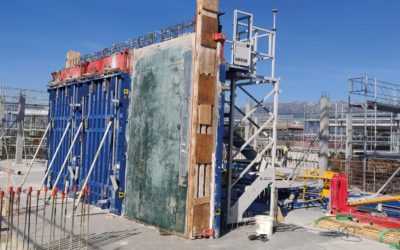culture - Débat
L’identité suisse à l’épreuve du doute
L’Institut national genevois (INGE) a récemment réuni quatre experts pour explorer un sujet aussi sensible que structurant: l’identité suisse. Les intervenants, venus d’horizons variés, ont confronté leurs regards sur ce qui constituait le socle helvétique. A travers une réflexion critique sur la Suisse d’hier, d’aujourd’hui et de demain, une conviction s’est dessinée: l’identité suisse, loin d’être un monolithe, demeure une construction vivante, traversée par ses tensions, ses paradoxes et ses réinventions. Un débat dense, animé par l’économiste Olivier Rigot.
Dominique Dirlewanger, historien, chercheur associé à l’UNIL et maître de gymnase (auteur de «Tell me, la Suisse racontée autrement») a d’emblée posé le cadre: «L’identité n’est ni univoque, ni naturelle. Elle est le fruit de nombreuses influences culturelles et linguistiques». Il évoque notamment la guerre du Sonderbund, les tensions entre catholiques et protestants ou encore la création du canton du Jura. Pour lui, l’identité nationale – qui s’est forgée à la fin du XIXe siècle – est une sorte de «bricolage» qui a permis de rassembler diverses populations et de pacifier les conflits internes. Cette identité helvétique reposerait davantage sur des mythes fondateurs, comme la neutralité, que sur une essence immuable.
Pour sa part, Jonas Follonier, journaliste et essayiste, rédacteur en chef du «Regard Libre» (auteur de «La diffusion du wokisme en Suisse»), voit dans les institutions suisses – démocratie directe, fédéralisme, système de milice – les véritables piliers de l’identité helvétique contemporaine. «C’est une construction qui privilégie la responsabilité individuelle, la décentralisation et l’autonomie locale», explique-t-il. Cette spécificité rend la Suisse «à part» sur la carte politique européenne, une forme de «miracle non planifié».
Nicolas Jutzet, vice-directeur de l’Institut Libéral, économiste et chroniqueur (auteur de «La Suisse n’existe plus»), pousse cette idée plus loin: la Suisse, dit-il, est une utopie réussie, précisément parce qu’elle n’a jamais été intentionnelle. Son succès réside dans son pragmatisme et une forme de méfiance ancestrale envers le pouvoir central: «Nous n’aimons pas les têtes qui dépassent». Ces caractéristiques pourraient toutefois se heurter aux bouleversements mondiaux actuels et au désenchantement croissant d’une partie de la population.
Un territoire idéal?
François Garçon, historien et essayiste franco-suisse (d’origine carougeoise), maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, auteur de «La France, démocratie défaillante, il est temps de s’inspirer de la Suisse»), a offert un regard exogène sur la Suisse, soulignant les différences structurelles avec la France. A ses yeux, notre pays est un «îlot de prospérité, de modération et de bon sens institutionnel», dont les voisins gagneraient à s’inspirer. Une situation favorable qui se manifeste par un PIB suisse élevé – le double du PIB français -, des caisses de retraite saines, des hôpitaux qui fonctionnent correctement et offrent des salaires attrayants, des milliers de travailleurs frontaliers… un tableau idyllique remis en question par Dominique Dirlewanger: «Une pauvreté endémique existe bel et bien, que le PIB ne parvient pas à mesurer. Les écarts de pauvreté sont aussi importants ici qu’ailleurs en Europe. Nous faisons face aux mêmes problématiques que celles rencontrées dans les pays voisins».
Le repli sur soi et un certain narcissisme national sont relevés, notamment visibles dans les crises de mémoire collective, comme l’affaire des fonds juifs en déshérence, encore douloureusement évoquée lors de la soirée. Dominique Dirlewanger insiste sur le manque d’introspection et le rapport problématique que nous entretenons avec l’histoire (des archives, notamment celles des banques, sont opaques et inaccessibles): «Les contradictions et difficultés qui marquent la Suisse nous coûtent cher; elles nous rendent incapables de nous défendre face à certaines accusations».
La conférence a abordé brièvement la question du wokisme, objet du dernier livre de Jonas Follonier. Tandis que celui-ci dénonce une idéologie importée d’outre-
Atlantique, accusatrice et qui pose un diagnostic erroné sur la société, Dominique Dirlewanger le met en garde contre une «panique morale», jugeant «dangereux» de discréditer des revendications d’égalité au nom d’un combat anti-woke. «Ce n’est pas en fuyant les débats qu’on renforce notre démocratie», déclare ce dernier.
La Suisse face aux défis de demain
Enfin, la soirée a permis de se projeter vers l’avenir. Vieillissement démographique, affaiblissement du lien entre élites et population, remise en question de la neutralité: plusieurs dynamiques questionnent la pérennité du modèle suisse. Pour Nicolas Jutzet, la Suisse se repose excessivement sur ses acquis, «dans une forme d’auto-satisfaction qui l’amènera droit dans le mur». Selon lui, notre pays est en train de perdre son avance, ainsi que sa volonté de se différencier sur le plan international. «Dans les années 90 – point de basculement mondial marqué par la chute du Mur de Berlin, l’ouverture des frontières et la globalisation des échanges – nous assistons en Suisse à l’émergence d’une forme de distanciation entre les trois pôles que sont l’économie, la politique et la population». Les élites se transforment: les Conseils d’administration deviennent plus internationaux; la classe politique s’éloigne des milieux économiques». Une situation dommageable à terme.
Dominique Dirlewanger relève que «la Suisse est toujours très sereine quand le monde va mal. C’est à ce moment-là que nous offrons les meilleures opportunités: franc comme valeur refuge, place bancaire et financière très connectée au monde, unique pays européen à disposer d’un accord de libre-échange avec la Chine, etc.». Les intervenants s’accordent à reconnaître une capacité d’adaptation profonde de la Suisse. «Une terre d’innovation qui continue d’attirer entrepreneurs et chercheurs», abonde François Garçon.
En guise de conclusion, Olivier Rigot pose une question aussi inattendue que provocante: et si les «secondos» – ces nouveaux citoyens suisses naturalisés après une décennie de résidence – incarnaient aujourd’hui le patriotisme helvétique le plus affirmé? Plus suisses que les Suisses eux-mêmes, jusqu’à parfois épouser les thèses de l’UDC?
Quoiqu’il en soit, la rencontre de l’INGE a montré, qu’entre fierté assumée, institutions solides et capacités d’adaptation, l’identité suisse semble moins figée qu’en perpétuelle redéfinition. Elle est le reflet d’un pays qui, même confronté à ses contradictions, continue d’interroger son propre mythe.