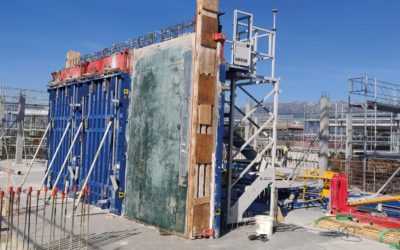SOCIéTé - Une étude de l’association Pro Persona
La transparence est-elle toujours synonyme d’éthique?
Très souvent, notre époque lance des appels à davantage de transparence, condition de plus d’éthique. Il est vrai que la transparence est porteuse d’une évidence: quand on ne fait que le bien, qu’a-t-on à cacher? Pourtant, la transparence, «stricto sensu», n’est pas sans poser des problèmes d’ordre moral. Alors «toute vérité est-elle toujours bonne à dire»? Tel est l’objet de la récente étude de l’association Pro Persona*.
La transparence, parfois un signe de méfiance.
Il y a une dimension intuitive dans le rapprochement entre transparence et éthique. En effet, compte tenu du caractère social de l’Homme, le bien se fait dans la clarté et, a contrario, l’opacité est de mise quand on veut faire le mal. Nombre de scandales, qui défraient la chronique en matière d’éthique des affaires, n’auraient pas eu lieu si des règles claires de transparence avaient existé. La «culture du secret» étant estimée à l’origine de tous les maux, il faudrait la combattre sans arrêt. Résultat: il semble évident que le mouvement visant à plus de transparence soit le même que celui allant dans le sens du progrès éthique. Moins on peut se cacher, plus on est dissuadé de faire le mal. Ou mieux: plus on est à découvert, plus on est poussé à faire le bien.
Une exigence (presque) toujours insatisfaite
Sans nier les progrès en matière d’éthique publique dus à l’aspiration à la transparence, il serait naïf de ne pas porter sur elle aussi un regard critique. En effet, le désir de transparence est-il si transparent que cela? Car ce qui est certain est que la transparence est souvent la compagne de la défiance: puisque sans transparence, les acteurs publics se rendraient coupables de toutes les malversations, celle-ci est la condition obligatoire pour qu’ils se tiennent correctement.
La transparence est alors l’expression de la méfiance. Et si elle est source de confiance pour la société, c’est en raison de la surveillance: quand on est surveillé, peut-on encore faire le mal? Qui plus est, n’étant jamais totale, la transparence est toujours insatisfaite. Cet apparent progrès éthique se paie donc au prix d’une régression globale, supposant et engendrant une société de la défiance et alimentant la tentation de développer toujours plus d’intelligence à contourner les mécanismes de transparence en place.
Quand on est sommé de devoir être toujours sur scène, on est alors tenté de multiplier les actions en coulisses, avec leurs recoins cachés.
Le choc de deux aspirations contradictoires
La revendication actuelle d’une transparence toujours plus grande se heurte également à une autre grande aspiration actuelle: la protection de la vie privée. Comment concilier besoin de tout savoir et droit à l’incognito? Comment prétendre accéder à une information sur tout et simultanément respecter le droit de tout un chacun à mener une vie privée qui reste… privée? Et donc quelle frontière tracer entre transparence et voyeurisme?
La question devient plus délicate encore sur les réseaux sociaux quand les mêmes personnes exposent leur vie privée par des textes, des photos, des vidéos, rendant ainsi leur vie transparente à tous, et exigent un respect inconditionnel de leur vie privée ou se cachent lâchement derrière des pseudonymes. La question devient aussi très complexe quand de nombreux acteurs publics, sous la pression des impératifs de la communication, ne font plus rien en dehors des caméras et déplorent, dans le même temps, que leurs moindres faits et gestes soient l’objet d’une forte curiosité.
Pas de vérité sans confiance
Un grand risque attaché à la promotion de la transparence est d’engager une vision de l’Homme et de la société qui se résumerait ainsi: étant donné que la méfiance règne entre les individus ou les organisations, compte tenu de la concurrence dans laquelle ils se trouvent, il faut instaurer des mécanismes de transparence, en vertu desquels les acteurs n’ont pas d’autre choix que de bien faire, se sachant surveillés.
Il serait cependant plus logique, et socialement bénéfique, de faire le pari inverse. En partant du principe qu’il appartient à la nature de l’Homme de vivre en société, tout en ayant constitutivement une vie intérieure inaccessible à autrui et en reconnaissant que le lien social demande la confiance, sans doute serait-il plus porteur de confier aux acteurs eux-mêmes le soin de manifester la vérité. Cela n’exclut pas certaines exigences de transparence toutes les fois où le bien commun le requiert. Du reste, la communication, comme son nom l’indique, devrait servir le bien commun de la société.
Quelle place pour le secret?
Dans cette vision des relations humaines, compte tenu que la manifestation de la vérité est régulée par des rapports de justice, il n’est pas suspect, mais légitime, que le secret non seulement existe, mais puisse faire l’objet d’une protection. Le secret n’est pas alors conçu alors comme un manquement à la transparence, mais comme la protection d’une connaissance qui n’est pas due à tous.
Du point de vue d’une transparence idéologique, toute non-manifestation de la vérité est un mensonge, alors qu’il existe quantité de situations où l’on ne ment pas quand on ne dit pas une vérité. Il suffit de penser aux secrets de fabrication, professionnel (secret médical par exemple), de l’instruction dans le domaine de la procédure pénale, militaire… Sans parler du fait que, dans cette conception des choses, la pudeur a aussi un sens, et même un sens éminent, car c’est la vertu par laquelle on garde pour soi ce qui n’a pas à être dévoilé aux autres: c’est la vertu de l’intimité.
Plus fondamentalement, l’intériorité étant constitutive de la personne humaine, la transparence ne respecterait pas sa réalité profonde. De ce point de vue, le droit à la vie privée est la conséquence du fait que l’Homme est une Personne. Nos pensées ne sont pas connues de tous… et heureusement. Mais, d’un autre côté, il est clair qu’existent des situations où le devoir qui s’impose est celui de la publication, consistant en une obligation de rendre publique une information pour une raison fondée en justice.
Moraliser le rapport à la
communication de la vérité
La transparence exprime donc une légitime aspiration à la vérité mais qui, prise à la lettre, n’est plus réglée par la justice, ce qui la rend tendanciellement totalisante (tout savoir tout de suite) et court-circuite la confiance sociale. D’autant que cette aspiration à une vérité totale est souvent très partielle ou sectorisée. Elle risque alors d’emporter au passage des biens précieux de la civilisation que sont le secret et la pudeur, mais aussi les bénéfiques précautions de l’institution judiciaire, au profit de justiciers qui livrent tout et immédiatement à la vindicte populaire ou médiatique.
La communication de la vérité n’est donc pas aussi simple que les partisans de la transparence l’affirment souvent. C’est la raison pour laquelle il importe au plus haut point de moraliser le rapport à la communication de la vérité, en la référant à la justice et au bien commun.
Michel Levron – Paris
* Pro Persona développe, dans un but non lucratif, une mission d’intérêt général à caractère scientifique, en contribuant à une recherche fondamentale et appliquée en faveur d’une finance au service de l’économie et une économie au service de la personne humaine. Elle s’adresse à un public large: acteurs de la vie économique et financière, enseignants et étudiants. www.propersona.fr