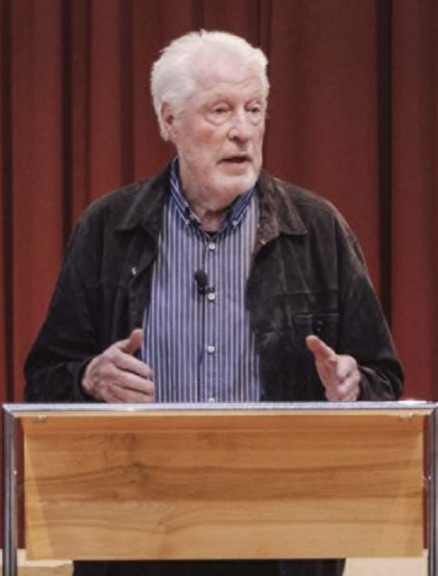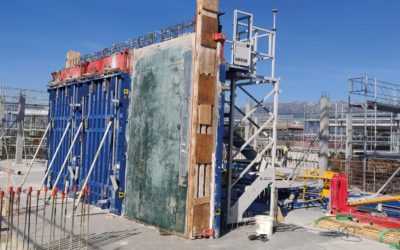mobilité - Conférence exceptionnelle à Genève
Repenser la mobilité au-delà des infrastructures
Dans le cadre du quartier d’affaires Lancy-Pont-Rouge s’est tenue une soirée passionnante dédiée à la mobilité, organisée par la Fondation FEDRE (voir Gros Plan), en partenariat avec le Crédit Agricole next bank. Un événement marqué par la conférence inspirante de Daniel Goeudevert, ancien président de Volkswagen, suivie d’une table ronde réunissant des figures clefs de la mobilité transfrontalière.
Dès les premières minutes, Pierre Fortis, directeur du développement et membre du Comité de direction de Crédit Agricole next bank, a rappelé l’enjeu de la conférence-débat: penser la mobilité autrement, à hauteur humaine et territoriale. Avec un discours profondément ancré dans les valeurs du développement durable, il a souligné la convergence entre la mission de sa banque et celle de la FEDRE. Pour lui, il s’agit de tisser des liens concrets entre les acteurs économiques, politiques et citoyens afin de relever les défis transfrontaliers.
Dans une allocution vibrante, Claude Haegi, président de la FEDRE et ancien président du Conseil d’Etat de Genève, a insisté sur la nécessité d’une vision globale de la mobilité, dépassant la simple addition d’équipements. «Unique au monde, notre bassin de vie transfrontalier génère de la prospérité, mais provoque aussi de multiples déséquilibres et inégalités. Ce territoire n’a de sens que par ses interdépendances et ses coopérations. Il est primordial d’envisager la mobilité en lien avec la vie quotidienne, la santé, l’emploi, le logement et l’équilibre social», a-t-il affirmé avec conviction. Les approches doivent conjuguer complémentarité et flexibilité. Et cela n’est envisageable, pour Claude Haegi, qu’à l’échelle du Diamant alpin, un territoire comprenant les régions jurassienne, rhodanienne, lémanique et alpine, et dont le Grand Genève ne représente «qu’un élément du puzzle».
Trouver une autre voie
La conférence de Daniel Goeudevert (ancien vice-président et actuel membre d’honneur de la FEDRE) fut le temps fort de la soirée. Avec une verve iconoclaste, l’ancien patron de Volkswagen est revenu sur un projet oublié: une voiture électrique conçue avec Nicolas Hayek, créateur de la Swatch. Un projet avorté dans les années 1990, trop en avance sur son temps. «L’industrie automobile n’a pas manqué de technologie, ni de financement. Elle a manqué de courage», a-t-il lâché, dénonçant le conservatisme politique et l’esprit corporatiste des milieux automobiles. Des postures qui ont retardé l’émergence de solutions durables, comme la constitution d’un réseau de recharge européen.
Les mutations dans le secteur automobile sont venues progressivement avec la prise de conscience environnementale des années 2000, puis avec Greta Thunberg qui a secoué les esprits. «Peu importe si elle a été manipulée ou non, jamais nous n’avons autant parlé d’écologie que depuis qu’elle a lancé le mouvement de grève pour le climat ‘Fridays for Future’».
A propos de l’incontournable Elon Musk et de sa marque emblématique, Tesla, Daniel Goeudevert n’a pas mâché ses mots. L’ancien patron de Volkswagen dénonce ce qu’il qualifie de «supercherie énorme», estimant que le produit «ne survivra pas» car il repose, selon lui, sur un argument marketing creux: l’accélération fulgurante des véhicules. Une prouesse technique qui, dit-il, n’a rien à voir avec les véritables enjeux de la mobilité. Il pointe en revanche le pragmatisme chinois: il y a un mois à peine, le constructeur BYD annonçait une innovation de rupture, une recharge de voiture électrique aussi rapide qu’un plein d’essence. «On n’aurait pas pu y penser avant?», ironise Daniel Goeudevert.
Sa conclusion est sans appel: «Il ne suffit pas de construire des voitures propres et ultraperformantes, il faut pouvoir répondre aux besoins des populations et à leur budget, tout en considérant l’impact sur l’environnement». Il y a une vingtaine d’années, à l’occasion du Salon international de l’automobile, ce visionnaire préconisait déjà d’adapter les gammes de véhicules aux territoires et d’en faire de même pour les carburants, en tenant compte des ressources disponibles. «La mobilité n’est pas la voiture. C’est une fonction humaine essentielle que l’automobile a, un temps servi, avant de la contraindre», résume-t-il.
La mobilité transfrontalière: une réflexion à 360°
Animée par Claude Haegi, la table ronde a permis d’enrichir le débat avec des perspectives opérationnelles et politiques. Sabrina Cohen Dumani, directrice de la fondation Nomads, a plaidé pour une approche systémique de la mobilité, intégrant des dimensions comme la formation, les entreprises, l’écologie ou la régulation. Se déplacer moins et mettre les moyens de transport en réseau pour favoriser la multimodalité sont des évidences; il est toutefois également nécessaire d’inciter les acteurs de la mobilité à collaborer, par exemple ceux en charge des vélos en libre-service et les TPG, notamment par le biais de pôles de mobilité implantés autour des arrêts de bus, comme cela se fait désormais à Genève. C’est l’un des objectifs du hub Mobilité déployé par Nomads: permettre à chacun de se déplacer selon son horaire et ses propres contraintes.
Représentant le ministre cantonal genevois Pierre Maudet, David Favre (directeur général du Département de la santé et des mobilités) a insisté sur le rattrapage nécessaire en matière d’infrastructures lourdes, dans la continuité de la réalisation du Léman Express; cela va de pair avec un aménagement du territoire pertinent visant à contrer la saturation du système. En effet, 660 000 véhicules traversent chaque jour la frontière. Claude Haegi a interpellé le responsable cantonal au sujet du futur métro, un projet qui relierait à terme le pays de Gex à la Haute-Savoie (liaison Jura-Salève) et permettrait de transporter quotidiennement 160 000 passagers. «Cette infrastructure sera certes légère et ‘agile’, mais quelle réflexion sociétale introduisez-vous? Comment inscrire une telle infrastructure dans un modèle de gouvernance satisfaisant?». Combler les retards ne suffit plus: encore faut-il savoir anticiper.
Pour le président de la FEDRE, la politique régionale transfrontalière demeure trop souvent réactive et manque cruellement d’ambition. Une limite flagrante, selon lui, illustrée dès la conception du Léman Express: «Le pays de Gex a été le grand oublié du tracé», déplore-t-il, soulignant l’absence d’une vision d’ensemble véritablement intégrée à l’échelle du territoire.
Claude Haegi, président de la FEDRE et ancien président du Conseil d’Etat de Genève.
Sabrina Cohen Dumani, directrice de la fondation Nomads.
Daniel Goeudevert, ancien patron de Volkswagen et actuel membre d’honneur de la FEDRE.
Miser sur une approche régionale territoriale
Christophe Castaner, président de l’ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc), a rappelé avec force que repenser la mobilité passe d’abord par un changement de regard sur la voiture. Dans une société où elle reste un symbole de statut social et de liberté, elle s’apparente de plus en plus à une contrainte, notamment pour les frontaliers confrontés aux embouteillages quotidiens vers Genève. A la tête d’une société reconnue pour son engagement environnemental, L’ancien ministre a plaidé pour des solutions concrètes et innovantes: covoiturage avec voies dédiées, véhicules électriques, auto-partage, vélos en libre-service ou encore titre de transport unique pour une mobilité fluide et multimodale. L’enjeu? Modifier nos représentations pour transformer nos usages.
Le directeur du Léman Express, Mathieu Fleury, a saisi la balle au bond en posant une question centrale: comment faire du train un véritable choix de vie plutôt qu’une contrainte par défaut? Pour séduire durablement les usagers, il estime que l’objectif est clair: «Offrir le même niveau de souplesse et de liberté que la voiture». Un défi qui suppose de repenser l’expérience ferroviaire, en misant sur la fréquence, la fiabilité, la simplicité d’accès et l’intermodalité. Dans la continuité des échanges, Claude Haegi n’a pas manqué de pointer une incohérence majeure: la dénomination Léman Express, qui occulte une réalité géographique pourtant évidente.
«Comment parler de Léman Express quand quatorze kilomètres manquent encore entre Evian et Saint-Gingolph?», interroge-t-il. Pour le président de la FEDRE, il s’agirait simplement de rouvrir une ligne ferroviaire existante. «Ce ne serait ni irréaliste, ni techniquement compliqué», insiste-t-il, dénonçant une occasion manquée de relier véritablement l’ensemble du pourtour lémanique. Dans la salle, des voix s’élèvent pour exprimer le désenchantement croissant de certains usagers du Léman Express. Travaux prolongés dans les gares, rames surchargées, correspondances trop serrées, incivilités à bord: autant de griefs qui entament l’enthousiasme initial. Un constat amer, reflet d’un système mis sous forte pression par son propre succès. Face à cette tension croissante, les usagers attendent désormais des signaux clairs et des réponses concrètes de la part des autorités politiques.
Vincent Scattolin, maire de Divonne-les-Bains, tire la sonnette d’alarme sur les enjeux de mobilité dans le bassin de vie transfrontalier. Selon lui, seule une mobilisation collective permettra de répondre efficacement aux besoins croissants de desserte entre les deux côtés de la frontière. «En matière d’infrastructures ferroviaires, il est impératif d’agir ensemble, avec plus de rapidité et de détermination. Nous ne pouvons plus nous permettre d’attendre des décennies, comme ce fut le cas avec le Léman Express», déclare-t-il. Pour l’élu, le développement harmonieux du territoire dépend directement de l’amélioration des connexions de transport. Le constat est le suivant: «Passer plus de 45 minutes en voiture pour rejoindre Genève ou Nyon depuis Divonne, ce n’est plus acceptable».
D’autant que, rappelle-t-il, lorsque des alternatives crédibles à la voiture sont proposées, elles rencontrent un véritable engouement. En toile de fond: le coût croissant de l’automobile et l’aspiration à des déplacements plus durables. Enfin, Vincent Pellissier, directeur général de la CGN, retenu, a été salué pour sa volonté de dépasser la vision purement lacustre de la mobilité. La complémentarité des modes – train, vélo, bateau – doit devenir la norme.
Une date fondatrice pour une mobilité partagée
Le 19 mai 2025 restera comme un moment charnière. Ce soir-là, le débat a dépassé les logiques techniques et les délais d’aménagement pour entrer dans une réflexion sociétale. Le message est clair: la mobilité du XXIe siècle ne se construira pas avec les recettes du passé. Elle nécessitera des coopérations renforcées, une planification audacieuse et une capacité à remettre en cause des habitudes solidement ancrées. Et comme l’a rappelé Claude Haegi pour conclure la soirée: «Genève ne peut se contenter d’être un îlot d’excellence. Elle doit se positionner comme un catalyseur d’innovations à l’échelle de son bassin de vie». Cocktail final, discussions animées et promesse d’un retour régulier à ce type de dialogue structurant.
Véronique Stein
GROS PLAN
La FEDRE: un pont entre régions pour construire l’Europe durable de demain
Créée en 1996, la Fondation européenne pour le développement durable des régions (FEDRE) est une passerelle entre les acteurs institutionnels et privés; elle a pour mission de promouvoir un développement durable à l’échelle régionale, transfrontalière et européenne.
Présidée par Claude Haegi, elle s’attache à faire émerger des solutions concrètes et collaboratives autour des grands enjeux du territoire: mobilité, énergie, fiscalité, environnement, cohésion sociale, etc. La FEDRE se distingue par sa capacité à fédérer les acteurs et à insuffler une vision systémique et pragmatique du développement régional. Parmi ses initiatives phares, le programme Diamant alpin se concentre sur le territoire entre Genève, Lyon et Turin ayant comme toit le Mont-Blanc.